Femmes paysannes et machines agricoles : combattre la domination masculine
Éleveuses de chèvres, de vaches laitières, de vaches à viande, de chevaux et de brebis… Elles sont encore peu nombreuses à gérer une ferme. Pour savoir comment elles envisagent leur métier de paysanne dans un environnement très masculin et comment elles concilient le travail avec leur vie familiale, j’ai parcouru les routes aveyronnaises afin de m’immerger dans le quotidien de femmes de tous âges et de tous horizons. Au menu : des revendications féministes, une affirmation de leur autonomie professionnelle, et un rapport aux machines qui cherche à déconstruire l’hétérosexisme au quotidien.

Quelque part dans le Nord-Ouest de l’Aveyron, début mars 2023. Il est sept heures trente. Nous sommes dans la fromagerie d’Emma, trente-cinq ans, à la tête d’une petite exploitation biologique d’une trentaine de chèvres sur sept hectares et demi de terres. Le contraste entre le froid de la neige qui tombe à l’extérieur et la chaleur humide et odorante de la fromagerie est saisissant. La « from’ », comme elle l’appelle, est attenante à la chèvrerie, où l’éleveuse ira bientôt effectuer la seule traite de la journée, réalisée à la main. Elle a choisi de traire une seule fois par jour de manière à gagner en confort de vie, malgré la légère baisse de rendement que cela engendre. C’est la première saison qu’elle tente de conduire son élevage en lactation longue, une pratique qui permet de réduire le nombre de naissances de chevreaux, tout en maintenant une production de lait toute l’année. Il s’agit d’une expérimentation qu’elle souhaiterait mener au long cours. Une manière d’avoir un rythme de travail plus lissé tout au long de l’année, sans mettre à mal le bien-être de ses animaux.
Le bâtiment et la maison en bois que l’on aperçoit en contrebas ont été en partie autoconstruits par Emma, son conjoint Rémi, et des coups de mains d’ami·es et de voisin·es, sans l’aide desquel·les le couple « ne serait rien ». Ce matin-là, c’est lui qui s’occupe de leurs enfants pendant qu’elle travaille. Elle redescendra ensuite à la maison vers neuf heures pour prendre le relais avec les enfants qui sont en vacances, pendant que Rémi partira travailler dans ses serres à quelques encablures de la maison. Emma et Rémi sont installés chacun·e en individuel, et gèrent leur entreprise agricole de façon indépendante, tout en s’entraidant au quotidien. En ce moment, une fois la traite effectuée et le travail à la from’ terminé, Emma et sa stagiaire placent quelques-uns des 400 piquets de clôture. Elle explique que sur des exploitations de couple, il arrive que « souvent le gars soit dans le tracteur, les piquets à l’arrière et que la nana pose les piquets. En fait, comme la femme est moins à l’aise avec la machine, ou qu’on lui a moins laissé la place, elle est beaucoup dans le corps ». La pose des piquets est une tâche très physique : il faut d’abord faire un trou dans le sol à l’aide d’une barre à mine, puis lever le lourd piquet au-dessus du trou, avant de le laisser tomber bien droit. Il faudra ensuite bien l’enfoncer dans le sol. Certain·es le font à la masse, d’autres au tracteur. Pour sa part, Emma décide de déléguer cette étape à une entreprise de travaux agricoles.
Des inégalités de genre dans l’accès aux machines
Être « beaucoup dans le corps ». Cette expression dit combien être paysanne, c’est effectuer des gestes répétitifs, difficiles et potentiellement douloureux, en ayant moins recours aux machines agricoles. Aux femmes les tâches qui ne nécessitent pas de compétences mécaniques et qui s’effectuent le plus souvent de façon invisible, en intérieur – la traite, la paperasse. Aux hommes les travaux des champs, assis en hauteur sur le tracteur. Nombreuses sont les paysannes qui combattent cette division sexuée des activités productives aujourd’hui. Un combat de longue haleine, car la division genrée du travail ne date pas d’hier dans le monde agricole. Elle explique pour Emma la distance des femmes paysannes avec les machines, à qui ce savoir-faire technique n’a jamais été transmis. C’est ce que montre aussi l’anthropologue féministe Paola Tabet (1) : la division du travail entre hommes et femmes est fondée sur l’appropriation des outils les plus performants par les hommes. Il s’agit là d’un des nombreux mécanismes de l’invisibilisation du travail des femmes en agriculture, qui n’acquièrent un véritable statut qu’au cours des années 1980. Elles ne sont alors plus seulement « femmes de ». Ou du moins sur le papier. Car aujourd’hui, alors que plus d’un quart des chef·fes d’exploitation sont des femmes, les stéréotypes de genre sont bien tenaces, souvent dès les formations aux métiers agricoles. Et ce, alors même que de plus en plus de femmes s’installent seules.
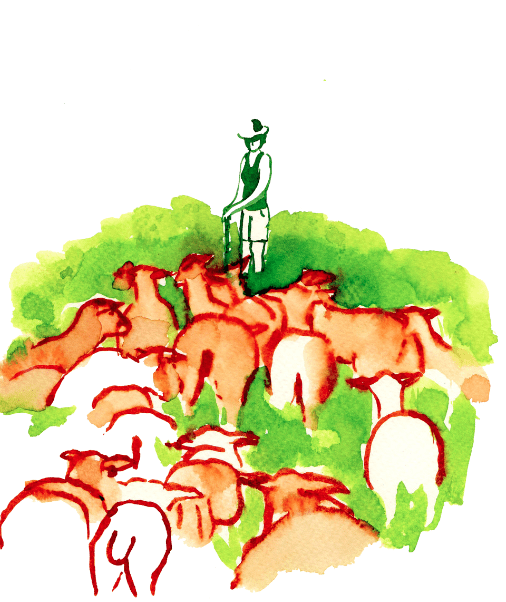
Ces mécanismes d’assignation genrés se jouent en particulier dans la formation à la conduite et à l’entretien du matériel agricole, comme le raconte Anaïs, trente-deux ans, éleveuse de chèvres dans le Sud de l’Aveyron : « Je n’ai pas été formée à la conduite des machines dans mon BTS agricole. C’est en stage sur les exploitations que j’ai pu conduire des tracteurs. Sauf que… je suis une femme. On m’a beaucoup moins laissée conduire qu’on laisse conduire un stagiaire garçon. Heureusement qu’il y a certains agriculteurs dans des stages qui m’ont appris. Mais je vois bien qu’aujourd’hui je suis moins autonome avec plein de machines que des mecs qui ont commencé en même temps que moi, parce qu’on les a laissés expérimenter. Alors que moi, deux fermes sur trois, on ne m’a pas laissée toucher un tracteur. » L’expérience d’Anaïs fait écho à celle de nombreuses femmes qui racontent qu’elles ont dû apprendre à manier certaines machines par elles-mêmes, sans l’aide de personne, les renvoyant ainsi à une solitude dont ne souffrent pas les hommes, à qui ces compétences sont toujours transmises.
Cette essentialisation des rôles genrés perdure au quotidien. Alors qu’elle travaillait comme ouvrière agricole, Anaïs raconte cette fois où elle est arrivée sur une ferme pour presser la paille. L’agriculteur ne lui a tout simplement pas laissé faire le travail. Elle se souvient encore de ses paroles : « Moi j’ai demandé un agent de remplacement qui vienne me presser la paille, et ils m’envoient une fille !? Je ne vais pas laisser un tracteur à 100 000€ entre les mains de quelqu’un comme toi ! » Autre exemple, lorsque Justine, quarante ans, éleveuse de vaches et de chevaux sur une ferme collective dans le Sud de l’Aveyron, s’est rendue à la CUMA (coopérative d’utilisation du matériel agricole). Elle raconte sa première rencontre avec les éleveurs présents : « J’arrive à la première réunion, que des bonhommes. Une femme était là, mais c’était pour nous servir le café, et elle a disparu ensuite. On ne me serre pas la main, on ne me dit pas bonjour. » Une entrée en matière qui en dit long sur la façon dont elle est perçue par ses collègues et voisins. Pourtant Justine ne baisse pas les bras pendant cette réunion : titulaire d’un permis poids lourd, elle s’y connaît en mécanique, et compte bien faire entendre son avis. « À un moment, on parle un peu d’engins agricoles. Certes, je n’ai pas la connaissance d’un homme qui fait ça tout le temps. Mais je prends la parole en utilisant des mots techniques pour parler des tracteurs. Et au final, en fin de réunion, tout le monde me serre la main en sortant, en me disant bienvenue parmi nous. Mais en fait, il faut faire tes preuves. »
Utiliser ou pas les machines ?
Faire ses preuves, se faire une place, jouer des coudes pour se faire entendre et être reconnue comme légitime dans un monde d’hommes. Autant d’efforts perpétuellement renouvelés (et souvent vains !) pour combattre la domination masculine dans le monde agricole, que certaines paysannes décident parfois de cesser de fournir. Pour certaines, l’alternative est alors de se retrouver pour se former uniquement entre femmes. En témoigne, depuis plusieurs années, le développement d’initiatives féministes menées par des paysannes qui se forment entre elles à la conduite et à l’entretien d’engins agricoles (2). Ces journées organisées en non-mixité par des paysannes leur permettent d’acquérir des gestes techniques, de gagner en autonomie et en confiance en soi, de créer un espace d’échange informel. Un espace où ces femmes ne se sentent pas jugées, et où elles peuvent échanger des astuces pour se faciliter le quotidien. À l’inverse, combattre le sexisme en milieu agricole peut aussi passer par d’autres canaux que celui de l’appropriation des machines dites « masculines ». Certaines paysannes renoncent ainsi délibérément à se servir de ces outils parce que, n’ayant jamais été formées à leur utilisation, elles ont finalement pensé la gestion de leur ferme autrement. Parfois avec une autre organisation, d’autres techniques, d’autres habitudes de travail. Parfois aussi en choisissant de déléguer ce qui ne constitue pas pour elles le cœur de leur métier d’éleveuse.
Ainsi, Emma s’est organisée pour ne pas avoir besoin d’utiliser le tracteur dans son travail quotidien. Cela est permis à la fois par son type de production, mais aussi par la répartition des tâches dans son couple : « Moi j’ai monté un système où j’ai très peu besoin des machines. Ma journée de travail est conçue sur la base de mes savoir-faire. Le tracteur, je ne m’en sers quasiment pas pour les chèvres. L’essentiel de l’alimentation de mes animaux se fait aux pâturages. Après le tracteur, si je devais le faire, je le ferai. Mais ça ne me fait pas rêver. Dans notre organisation avec Rémi, on a mis en place une banque de travail. Moi je vais l’aider aux serres, et lui il me fait les foins. » Le système de banque de travail permet au couple de s’entraider sans être en GAEC (groupe agricole d’exploitation en commun), en particulier pour les travaux nécessitant l’utilisation des machines qui représentent finalement tout au plus « une dizaine de jours de travail sur l’année » explique Emma. Une répartition du travail qui repose aussi pour l’éleveuse sur le poids des habitudes genrées et sur la difficulté de se battre contre la domination masculine au quotidien : « J’ai bien conscience que de ne pas savoir conduire le tracteur me rend dépendante d’autrui et ici de mon mec, dans certains travaux liés à mon activité professionnelle. Seulement, pour le moment, ça me convient de ne pas mettre trop d’énergie dans cet apprentissage, car la mécanisation ne représente pas un gros enjeu sur ma ferme. Le temps que je devrai mettre à devenir autonome et à l’aise dans la conduite et l’entretien des outils me paraît énorme. » Pour le moment, Emma se consacre à d’autres combats féministes, « notamment celui de la répartition des tâches dans la sphère familiale, en particulier au niveau du “care”. Comment dans un couple, dans une famille, qui plus est de paysans où la sphère privée et professionnelle sont si liées, le soin aux autres doit devenir une priorité pour chacun. Comment faire en sorte que l’homme ne fasse pas passer avant tout son activité professionnelle, quand la femme fait des équilibres relationnels de la famille sa priorité. En fait, il est là mon combat : que ces tâches dites “féminines” soient valorisées et partagées. Et au fond, il représente quelque chose de bien plus prioritaire que de savoir conduire un tracteur dix jours par an. »
Le corps comme outil de travail
Emma n’a pas tellement d’appétence pour les machines, qu’elles soient habituellement réservées aux hommes ou non. Elle a d’ailleurs choisi de traire ses chèvres à la main, comme le faisait l’éleveuse qui lui a transmis son troupeau : « J’adore ça ! C’est vraiment un truc que j’aime. J’aime ce silence du matin. Le bruit de la machine, ça me rebute. » Une pratique qui, en plus de rendre les fromages de chèvres plus doux, permet à Emma de maintenir au quotidien un contact direct avec son troupeau : « La traite, c’est le seul moment qu’on passe vraiment ensemble. Après, elles sortent manger dehors jusqu’au lendemain matin. C’est mon seul moment d’observation du troupeau. Je pense que si elles passaient toutes sur le quai de traite, je ne verrais pas du tout les mêmes choses ! » La traite à la main, sans la médiation de la machine à traire, est une façon pour Emma d’observer et de surveiller ses bêtes, de les toucher et de maintenir au jour le jour un lien physique direct avec elles. « Cela fonctionne parce que j’ai un troupeau d’une quarantaine de chèvres. Au-delà, il serait compliqué de maintenir cette pratique » précise-t-elle. Finalement, la traite manuelle est aussi une façon de prendre soin et de déployer l’une des compétences centrales du métier d’éleveuse : l’observation du troupeau par la vue et le toucher. Ce sont donc ses mains, et non la machine, qui constituent l’outil du travail quotidien d’Emma. Un outil indispensable et précieux dans ses tâches quotidiennes, qu’elle cherche à préserver. C’est en partie pour cela qu’elle appréhende d’utiliser des outils comme la scie circulaire ou la tronçonneuse. Elle n’a pas envie de prendre le risque de blesser ses mains, même si elle « pourrait prendre le temps d’apprendre un jour ».
Sortir d’une conception du travail comme labeur ?
Si les paysannes sont « beaucoup dans le corps », ce n’est peut-être pas seulement parce qu’elles ont moins accès que les hommes aux machines. C’est sans doute aussi parce leur position de dominée les conduit parfois à « en faire trop pour montrer qu’une femme peut le faire », comme le pense Anaïs qui a déjà été opérée à deux reprises des ligaments croisés à force de manier la fourche « comme une bourine », et qui souffre d’endométriose mais a « appris à serrer les dents ». Et à envisager son corps lui-même « comme une machine qui doit fonctionner coûte que coûte ». Au risque de se blesser, ou de ne pas s’arrêter quand le corps le réclame. Justine renchérit : « De toute façon, à la fin, le boulot il faut qu’il soit fait, douleurs ou pas douleurs ! » Le travail quotidien des éleveur·euses implique une accoutumance à un certain nombre de tâches potentiellement douloureuses : le corps-à-corps quotidien avec les animaux qu’il faut traire, soigner, déplacer, le port répété de charges lourdes, le contact prolongé des mains avec l’eau, les produits de nettoyage, le froid, la chaleur, l’accommodation aux odeurs et aux bruits. Autant de gestes répétés jour après jour qui entraînent une véritable usure physique du corps sur le temps long. Une usure qui, le plus souvent, ne s’arrête pas aux portes de la ferme, mais qui est prolongée par le travail domestique, encore largement pris en charge par les femmes au sein des couples hétérosexuels… « Si on me prend 50% des tâches domestiques, je veux bien trouver le temps de me former au tracteur ! » conclut Justine. Emma, quant à elle, se demande si l’un des combats du monde agricole ne serait pas de cesser de valoriser le travail comme labeur, « douleur ou pas douleur », mais plutôt de considérer le respect et le bien-être de l’humain et de son corps dans le travail. Pour des paysannes, nombreuses, reconnues, valorisées et non usées !

Texte : M.B / Illustration : Alys
_______________________________
(1) Tabet Paola, Les doigts coupés. Une anthropologie féministe, Paris, La Dispute, coll. « Le genre du monde », 2018.
(2) Voir par exemple les collectifs en non-mixité du réseau CIVAM (centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural), notamment pour se former techniquement et échanger sur ses pratiques professionnelles. En ligne : https://www.civam.org/femmes-et-milieu-rural/collectifs-en-non-mixite/

Ping : Khrys’presso du lundi 11 décembre 2023 – Framablog