« On est là pour douter et normalement, vous aussi »
Sept personnes ont été arrêtées au petit matin du 8 décembre 2020 en cinq endroits de France par une centaine de policiers du RAID et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) armés de fusils mitrailleurs. Elles sont jugées du 3 au 27 octobre par le tribunal correctionnel de Paris pour « association de malfaiteurs terroriste ». Le parquet les présente comme des « militants d’ultragauche » et leur reproche d’avoir eu le projet de « commettre des actions violentes à l’encontre notamment de membres des forces de l’ordre et de militaires, en vue de déstabiliser les institutions républicaines par l’intimidation ou la terreur ». Les services secrets ont surveillé Florian D. lorsqu’il est revenu du Rojava, le Kurdistan syrien, où il combattait Daesh (1). Ils ont monté un dossier contre lui à partir de suppositions. Récit des premiers jours d’audience.
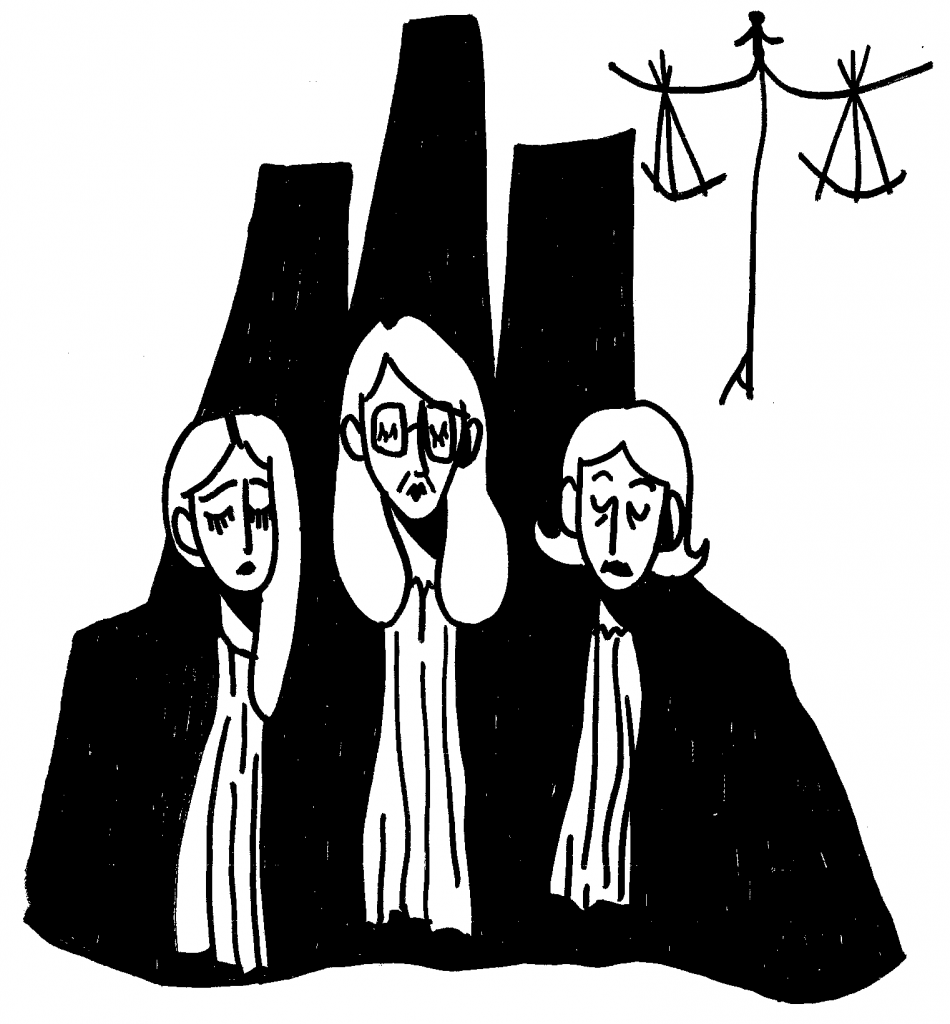
Que des prévenu·es (2) qui risquent dix ans de prison sans être accusé·es de faits précis soient tendu·es, cela se comprend aisément. Que des magistrat·es soient aussi nerveux·ses et flou·es à leur poste de travail est plus étonnant. La juge qui avait relaxé les inculpé·es de Tarnac en 2018 avait paru sereine et satisfaite d’incarner une justice qui invalidait certaines pratiques policières. Au tribunal judiciaire de Paris le 3 octobre, premier jour du procès de l’affaire baptisée par la DGSI l’affaire « punks à chien », puis plus fréquemment nommée « du 8 décembre », la présidente de la 16ème chambre correctionnelle, Brigitte Roux, fait corps avec la thèse policière : elle considère avoir en face d’elle des gens dangereux et elle le montre. Elle met en garde les 150 personnes qui remplissent la salle d’audience, qu’elle doit assimiler à une meute d’ultragauchistes violent·es : « Je ne tolérerai pas le moindre mouvement… (dix secondes de silence) Vous pouvez vous asseoir. » Les prévenu·es et le public venu en soutien ont passé trois fouilles : l’inspection des sacs à l’extérieur du tribunal, le scanner intégral au rez-de-chaussée et une dernière détection de métaux par des policiers spécialement affectés à la salle 2.13, au cas où certain·es se seraient procuré des armes dans l’escalator.
Amour de la police
Les premiers jours sont consacrés aux interrogatoires des sept prévenu·es. La présidente s’intéresse aux trajectoires de chacun·e depuis leur majorité. Les questions sont centrées sur les valeurs qui animent ce tribunal, le travail et l’ordre. L’assesseure assise à sa droite ne masque pas son amour de la police et sa crainte que tout le monde ne le partage pas. Plusieurs des accusé·es sont passé·es par les luttes des ZAD, ce qui semble la chiffonner : « Y a-t-il eu un problème précisément avec les forces de l’ordre en ce qui vous concerne ? Vous n’avez pas de ressentiment contre les forces de l’ordre ? » L’autre assesseure enchaîne avec une attitude douce et maternante : « Avoir côtoyé la mort de Rémi Fraisse vous a-t-il donné envie de vous venger ? »
Pour faire étalage de son éloquence, le procureur Benjamin Chambre commence par une rime riche : « Je vois que la défense manie l’art oratoire, mais aussi l’art dilatoire » (3), à propos de la demande de renvoi d’un avocat qui demande d’attendre un arrêt du Conseil d’État qui doit statuer sur les écoutes menées par une DGSI en autonomie totale. Un homme du public proteste à haute voix « La Stasi (4), c’est fini ! », ce à quoi la présidente répond en bredouillant un étonnant « la Stasi n’existe plus en France » et en excluant le fauteur de trouble.
Tout le dossier a été écrit par des agents de la DGSI, qui bénéficient de l’anonymat et signent d’un nom de code. « 856 SI » a espionné les accusé·es en écoutant le son capté par un micro dans un camion, puis rédigé des synthèses qui atterrissent aujourd’hui directement au tribunal. Coline Bouillon, avocate de Florian D. aux côtés de Raphaël Kempf, cherche à faire venir ce « 856 » à la barre, pour au moins « interroger la psychologie des enquêteurs » et poser des questions à la toute puissante DGSI. Mais, déplore-t-elle : « l’entrée de la DGSI a été refusée à l’huissier [porteur de la convocation] parce qu’il n’avait pas l’identité de l’agent ! » Imparable. La présidente feint l’impuissance : « Ce n’est pas possible d’aller les chercher de force », ce que regrette Louise Tort, avocate d’un autre prévenu : « On est là pour douter et normalement, vous aussi. » Pour l’affaire de Tarnac, les avocat·es avaient pu interroger les fonctionnaires de la police antiterroriste.
Le deuxième jour, le procureur hasarde un second trait d’esprit : « L’article 6 [de la convention européenne des droits de l’homme] est devenu le véritable ‘‘point Godwin’’ des plaidoiries de la défense ». L’argument caricatural sur la comparaison avec le nazisme passe mal. « Insupportable ! » répond Raphaël Kempf, s’agissant de l’article sur les droits de la défense et de sa jurisprudence abondante, qui définissent les bases d’un procès équitable.
Les intentions suffisent
Et les « faits » ? À l’heure où nous mettons sous presse, les accusations ne sont pas abordées frontalement. La juge rappelle les intitulés des poursuites : « association de malfaiteurs terroriste » pour les sept, et « refus de remettre une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie » pour trois d’entre eux. Une assesseure demande à une accusée s’il existe un lien entre « les faits » et le mémoire de lettres modernes qu’elle a rédigé dix ans plus tôt sur la place de la guerre dans les œuvres de trois romanciers. Mais quels faits ? L’association de malfaiteurs terroriste, introduite dans le code pénal en 1996, a ceci de magique qu’il n’y a pas besoin de faits pour condamner quelqu’un·e. Des intentions supposées suffisent. Et que sont des intentions ?
Après son interrogatoire de deux heures et demie jeudi 5 octobre, il sera difficile au procureur de faire passer le principal accusé pour un chef terroriste. Le service « ultragauche » de la DGSI a tissé un récit entre son expérience au Rojava en guerre, son ami spécialiste des feux d’artifices, une de ses connaissances passionnée d’armes et l’idée selon laquelle si on utilise Signal ou Tor c’est qu’on a des choses à cacher.
Ému aux larmes, le soi-disant « leader » raconte son modeste soutien aux Kurdes contre Daesh, et la souffrance endurée durant ses seize mois d’isolement carcéral. Une prise de parole qui le rend assez incompatible avec l’image officielle du stratège organisant la guérilla depuis Toulouse. Quand je vois le dossier, il n’y a pas 1% de ma personnalité dedans. (…) Je me sens insulté par cette procédure ». Comme plusieurs autres, Florian D. se décrit comme itinérant, semi-sédentaire, en recherche de terrain pour « poser son camion », « faire pousser des légumes » et vivre avec « un peu d’autonomie ». À la Zad de Sivens en 2014, « pour le dire de façon très stéréotypée, j’étais plutôt proche des milieux punk et là je suis entré plus en contact avec des milieux hippies. » Affecté par la destruction de la forêt à Sivens, il quitte la zone avant le pire des confrontations. « La seule chose que j’ai réussi à faire c’est courir à côté des gendarmes, faire le guignol pour ralentir la destruction ». Cherchant à « [se] sentir utile » et à « donner du sens », il donne des cours de français à la « jungle » de Calais en 2016. Au plus fort de la violence de Daesh en France et au Moyen-Orient, il « commence à comprendre le mouvement kurde », lit « beaucoup de livres », visionne « toutes les vidéos » disponibles et mûrit longuement sa décision : rejoindre le « confédéralisme démocratique » au Rojava. « [Avant d’y aller], je n’avais aucun entraînement militaire (…), je n’avais jamais tiré un coup de feu ». « Je ne suis pas parti sur un coup de tête. J’ai passé beaucoup de temps à méditer [avant de partir] ».
Dès que l’accusé entame un bout de ce récit de vie assez touchant, la présidente le reprend. Comme si elle ne voulait pas plonger dans la réalité, complexe, d’un Occidental peu aguerri mais convaincu du bien-fondé du combat kurde, et rester sur ce qu’indique le dossier de la DGSI : une tendance à la violence. « Sur le front, comparé à d’autres, mon expérience a en fait été plutôt soft. Je n’ai vu personne de mes plus proches mourir à mes côtés par exemple. (…) J’ai été chanceux. (…) Il y a eu beaucoup de temps à l’arrière, à ne rien faire. Et plein de belles choses avec les gens sur place. Je n’ai peut-être pas apporté grand-chose. Et j’en ai retiré beaucoup.»
Construire un personnage de chef
Dès son retour en 2018, il comprend qu’il est surveillé. « Un contrôle routier de routine qui durait 5 minutes, maintenant c’est 45 minutes, avec des gendarmes qui deviennent tout pâles en lisant ma fiche sur leur écran. (…) Un jour pour me dire que mon chien est sous le camion, c’est une quinzaine de flics avec des mitraillettes qui arrivent ! (…) J’ai dit à ma mère : j’ai peur de finir en prison ou qu’on me tue ». Pendant sa surveillance, il se rend en Belgique rencontrer des personnes qui projettent également d’aller aider les Kurdes. « Il y en a qui partent un peu sur un élan romantique, et qui sur place se font buter pour rien. (…) Je voulais surtout les mettre en garde ». Une assesseure en déduit que parler à des personnes qui partent au Rojava, c’est nécessairement les conseiller militairement. « C’est un peu contradictoire monsieur. Vous allez parler à des gens mais vous ne leur donnez pas de conseils ? Même sur le maniement des armes ? ». La ficelle est grosse : l’accusation doit construire un personnage de chef de cellule armée. Même la présidente montre sa gêne vis à vis de la lourdeur de sa collègue.
Devant cette 16ème chambre spécialisée dans le terrorisme qui voit le reste du temps défiler des partisans de Daesh à la barre, Raphaël Kempf suggère à son client de rappeler à quoi ont notamment servi les volontaires internationaux. Ils et elles combattaient les islamistes retranchés dans leur capitale de « Raqqa, là où ont été préparés les attentats du 13 Novembre. » Florian D. explique : « L’avantage qu’on avait [sur Daesh], c’était la coalition internationale. » Seuls présents au sol, les Kurdes et leurs soutiens donnaient les coordonnées GPS des positions islamistes à l’aviation américaine et française, qui les bombardait aussitôt. « Donc vous avez travaillé en bonne intelligence à ce moment-là avec une institution française, l’armée ? » demande l’avocat à son client ». « – Oui. »
À des visions glaçantes succèdent parfois des échanges plus légers comme lorsqu’un coaccusé, ami de longue date de Florian D., employé comme artificier à Disneyland et en effets spéciaux cinématographiques, explique les bases de son métier au procureur et fait s’effondrer en deux minutes tout le pan de l’accusation consacré aux « expérimentations avec les explosifs ». Les amis ont été espionnés un jour du grand confinement de 2020 où ils mélangeaient des substances. « En cinéma, on ne s’ennuie jamais, on ne fait jamais deux fois le même effet. Si la production veut des étincelles dans une forêt, je dois trouver le matériel, inventer le dispositif. (…) Il y a un gros flou juridique sur les tournages, c’est un peu le jeu du chat et de la souris sur ce qui est autorisé ou pas. (…) On peut employer des substances avec marqué ‘distance de sécurité :100 mètres’ et avoir un acteur à 5 mètres du truc. (…) Dans le monde des effets spéciaux, on détourne très souvent les produits de leur usage théorique. » Le procureur, peu au fait de l’économie du spectacle, tente « Mais on n’acquiert pas soi-même son matériel ? » et l’accusé rétorque « Ben si ! »
La première semaine se termine sans que l’accusation ne détaille certaines pièces à charge : des paroles du principal accusé, en général au cours de soirées alcoolisées, qui fanfaronne parfois à propos de la violence révolutionnaire, et des considérations à son sujet arrachées en garde à vue à des coaccusés.
Juges et parquet feront mine d’ignorer que les peines déjà subies par les accusé·es (cf ci-contre) sont de toute évidence déjà extrêmement lourdes et dissuasives de toute action politique à l’avenir : des arrestations traumatisantes, des mois de prison avec isolement et fouilles à nu, des noms à jamais googlisables, des intimités étalées, des proches bouleversés ou coupant tout contact et des perspectives de vie détruites. Pour rien, en tout cas pour aucun fait. Pour montrer que la DGSI surveille de près les révolutionnaires.
Texte : Alan Balevi / Illustration : Flotte
1 : Au Rojava la lutte contre Daesh est menée en même temps qu’une révolution féministe et pour la démocratie directe.
2 : Juridiquement, « prévenu » et « prévention » concernent les procédures correctionnelles et « accusé » et « accusation » les procédures criminelles. Ici la procédure est correctionnelle mais nous utilisons indistinctement « accusé·e » qui est dans le langage courant. « Inculpé » a été remplacé en droit par « mis en examen » mais demeure aussi dans le langage courant.
3 : Se dit d’une manœuvre visant à gagner du temps.
4 : Police politique en Allemagne de l’Est de 1950 à 1989.
L’État déjà condamné deux fois dans cette affaire
Accusé de tenir un rôle central dans le dossier, Florian, aka « Libre Flot », a été maintenu seize mois à l’isolement en détention provisoire de décembre 2020 à avril 2022. Dénonçant l’usage d’une « torture blanche », il a suivi une grève de la faim pendant 37 jours avant d’être hospitalisé et libéré sous bracelet électronique. En avril 2023, le tribunal administratif a reconnu l’illégalité des deux prolongements d’isolement et a condamné l’État à l’indemniser.
Une des accusées a dénoncé les dizaines de fouilles à nu « dégradantes et humiliantes » qu’elle a subies en prison. Seules deux ont été reconnues illégales. L’État a été condamné à lui verser… 200 euros.
Le retour des lois scélérates
Alors que les soutiens dénoncent un procès politique, cette affaire révèle comment l’arsenal policier, administratif et judiciaire de l’anti-terrorisme s’appuie sur la répression préventive et la présomption de culpabilité.
La sensation d’être un personnage de fiction. C’est l’impression partagée par ces sept inculpé·es en découvrant, dans ce dossier de plus de 7000 pages (auquel L’Empaillé a eu accès), des bouts de vie captés et consignés par les renseignements. Lancé en 2018, le dispositif de surveillance accumule des écoutes de lignes téléphoniques, des filatures, la sonorisation de lieux privés ainsi que la collaboration d’organismes sociaux et bancaires. Le récit policier tient dans l’assemblage et l’articulation de ces éléments et dresse un scénario inquiétant : un groupe d’activistes d’ultra-gauche se prépare à « importer la guérilla en France ». Ainsi, les protagonistes se retrouvent définis comme un groupe (même si tous et toutes ne se connaissent pas) où chacun·e occupe une place opérationnelle : un leader charismatique, un psychologue, un artificier…
L’accusation repose largement sur les suppositions et interprétations des services de renseignements. Ainsi, un voyage touristique en Colombie devient une rencontre avec la guérilla colombienne ELN ; la participation à deux séances d’airsoft (un jeu avec des armes en plastique), un entraînement paramilitaire ; une blague tendancieuse sur la police, la preuve d’une velléité de passage à l’acte. Certes, des armes ont été retrouvées aux domiciles de certains interpellé·es, dont certaines non déclarées. Et des inculpé·es se sont adonnés à des expérimentations chimiques. Mais absolument rien n’atteste l’existence d’un projet d’attentat, ni même d’une cible potentielle. Face à ce vide, comment expliquer la détermination de la DGSI et du Parquet national antiterroriste (PNAT) à les poursuivre ?
Les besoins de la DGSI
Tentons une mise en contexte. La surveillance commence en 2018 lorsque Flo, l’un des accusé·es, rentre en France après avoir passé près d’un an au Rojava. Il fait partie des dizaines de militant·es internationalistes qui, depuis 2015, ont choisi de rejoindre et soutenir la communauté kurde en Syrie contre Daesh. Il rejoint les YPG : les unités de protection du peuple, branche armée du PYD, considérée comme la branche syrienne du PKK.
En 2019, la DGSI exprime dans Mediapart (1) ses craintes sur le retour de ces militant·es révolutionnaires formés au maniement des armes. On comprend qu’un large dispositif de surveillance entoure ceux et cellles qu’elle désigne comme les « revenants du Rojava » formant des « cellules pré-terroristes ».
Comment expliquer la judiciarisation de l’affaire ? Le besoin pour la DGSI de justifier le temps et les moyens engagés dans la surveillance de ces militants internationalistes ? Le reflet d’une politique sécuritaire plus globale, dans laquelle l’anti-terrorisme occupe une place de choix ?
Les années qui ont précédé l’enquête sont marquées par plusieurs changements pour les services de renseignements qui ont élargi leur pouvoir et consolidé leur place dans le traitement des affaires anti-terroristes. La DGSI est née en 2014 sur les cendres de l’ancienne Direction centrale du renseignement intérieur.
Au lendemain des attentats de Paris et de Nice, les budgets assignés à l’anti-terrorisme augmentent. La DGSI en est un des premiers bénéficiaires. De 2017 à 2018, son effectif augmente de 20%. Parallèlement, Le « plan d’action contre le terrorisme » promeut une politique de répression préventive et préconise la coordination entre les renseignements et la chaîne pénale anti-terroriste. Cela débouche en 2019 sur la création du PNAT, parquet composé de procureurs spécialisés dans l’anti-terrorisme.
On peut douter qu’une juge récuse le travail de la DGSI tant police et justice sont liées par le continuum répressif de l’antiterrorisme. La justice a opéré son « tournant préventif », avec notamment l’inscription du délit d’association de malfaiteurs dans le droit pénal en 1996. Depuis, cette tendance à juger non pas l’acte mais l’idée s’est confirmée, comme l’illustre le vote en 2014 du délit d’apologie du terrorisme qui inscrit le délit de presse et d’opinion dans le droit commun.
La preuve par l’absence de preuve
La répression préventive s’affirme aussi via la menace des libertés numériques. Dans une tribune consacrée à l’affaire (2), l’association Quadrature du net revient sur l’inculpation pour « refus de remettre une convention chiffrée d’un moyen de cryptologie ». Dans ce dossier, en effet, les outils permettant de protéger sa vie privée sur internet (Signal, Tor) ont été associés à un comportement « clandestin », « complotiste », donc toujours coupable. Si l’on suit cette logique, l’absence de preuve devient une preuve.
Dans « Ennemis d’État » (3), Raphaël Kempf, avocat dans cette affaire, fait le lien entre les lois scélérates qui ont visé les anarchistes à la fin du 19ème siècle et les actuelles loi anti-terroristes. Si les dernières ne touchent pas uniquement les anarchistes, elles impliquent une justice préventive et permettent la condamnation d’une idée ou d’une opinion politique. Cette affaire en est un cas d’école puisqu’en l’absence de preuves, le réquisitoire du PNAT s’appuie entièrement sur l’affiliation supposée des accusé·es à l’histoire de « l’ultragauche ». Mentionnons au passage que l’objet « ultragauche » est dans ce dossier défini uniquement par son rapport à la violence politique, jamais par des idées.
Maddie B.
1 : « Ces revenants du Rojava qui inquiètent les services de renseignement », Mediapart, septembre 2019.
2 : « Le chiffrement des communications assimilé à un comportement terroriste », La Quadrature du Net, juin 2023.
3 : La Fabrique, septembre 2019.
