La Dépêche, Pétain et les nazis : épisode 2/3
Un naufrage annoncé
Du haut de son empire médiatique, la famille Baylet n’a jamais eu à rendre de comptes sur l’attitude de ses prédécesseurs entre 1940 et 1944. C’est bien dommage. Pour l’histoire, comme pour le présent, qui se nourrit des combats passés comme des périodes sombres que l’on ne veut plus jamais revivre. Le clan Baylet défend une Dépêche imaginaire qui n’a rien à se reprocher, victime des nazis et de ses opposants politiques à la Libération. Toutes les autres sources – historiens, résistants, journalistes – débattent de la réalité historique : attentisme coupable ou collaboration consciente, voire zélée ?

« Nous sommes fiers de notre histoire. Elle se confond largement avec celle de la République et La Dépêche fut de tous les combats pour la défendre ». Ainsi s’exprime en 1997 l’actuel patron du groupe1. Grâce à son monopole et servie par une sphère politico-médiatique au garde à vous, la famille Baylet a su imposer sa vérité : le grand journal de gauche a maintenu l’espoir d’un retour de la république pendant ces années d’occupation, subissant les foudres de Vichy, de la milice et des allemands. Il a bataillé contre la censure et aidé la résistance avant de subir le martyre.
Nous avons déjà mis à mal cette vision idyllique dans le précédent épisode2, en montrant combien, au travers des 1500 numéros parus après l’armistice, La Dépêche avait collaboré et été d’une aide précieuse aux allemands. Elle n’a eu de cesse de prôner la révolution nationale d’un gouvernement d’extrême droite, de s’attaquer à la résistance, puis de relayer la propagande nazie. Il s’agit désormais d’étudier l’attitude de ses dirigeants, et les raisons qui les ont poussé à ne pas se saborder et à poursuivre l’impression du quotidien jusqu’au dernier jour de l’occupation. À commencer par ce spectaculaire revirement en juin 40, où après avoir appelé les français à sortir les fusils, le directeur Maurice Sarraut devenait subitement un partisan de l’armistice et de la prise de pouvoir de Pétain. Pour le comprendre, un petit retour en arrière est nécessaire afin de savoir de quoi La Dépêche est-elle le nom en 1940.
Un journal versaillais
En évoquant La Dépêche, on l’assimile volontiers à un journal progressiste, à ses grandes signatures – Jaurès en tête, à la défense de la démocratie. Seulement jusqu’en 1940, c’est très loin de la réalité. Dès ses débuts, en 1871, elle condamne l’insurrection de la commune de Paris. Son rédacteur en chef Louis Braud, s’extasie alors devant « la leçon de bravoure et de tactique guerrière donnée par l’armée de Versailles qui a délivré la capitale de la république du joug odieux et féroce de la commune »3. Le massacre des communards par les troupes d’Adolphe Thiers n’émeut guère le quotidien, même s’il appelle à la modération de la répression. Les années suivantes, son soutien à cet ancien monarchiste ne se démentira pas. Quand à Louis Braud, ennemi du peuple s’il en est, il gardera son poste jusqu’en 1917.
Le quotidien se range systématiquement derrière cette république bourgeoise, autoritaire, conservatrice. En ce début de 20ème siècle, que ce soit sous les gouvernements de Waldeck-Rousseau, Combes ou Clemenceau, « la Dépêche fait figure de journal gouvernemental »4, affirme l’historien Henri Lerner. Georges Clemenceau, briseur de grèves notoire qui n’hésitera pas à faire tirer sur les ouvriers, aura ainsi les faveurs du quotidien et de ses dirigeants. Par la voix de son journaliste vedette Arthur Huc, le quotidien préconise des sanctions très sévères contre la CGT, s’oppose au syndicalisme de fonctionnaires et dénonce les actions illégales.
À droite de préférence
Tout au long de ces années, les frères Sarraut ont un rôle prépondérant. Avec Arthur Huc, Maurice tient La Dépêche et le parti radical, tandis que son frère Albert participe à de nombreux gouvernements. Avec eux, le journal soutient « l’union sacrée » et les Ministères qui se succèdent durant la première guerre, puis il renouvelle son soutien à Clemenceau en 1917 alors qu’il réprime à nouveau férocement le mouvement ouvrier. Dans les années 20, Albert Sarraut intègre les gouvernements droitiers de Poincaré, sous les applaudissements du quotidien de son frère. Après la parenthèse du Cartel des gauches, vite oubliée, La Dépêche adhère à l’union nationale en 1926, où Albert Sarraut est embauché comme ministre de l’intérieur. Elle se prononce pour la restauration financière et les mesures de rigueur, Poincaré est acclamé comme le « libérateur de la rente ». Arthur Huc célèbre les « vertus de la collaboration morale entre patrons et ouvriers pour sortir de la crise »5. Pour Henri Lerner, La Dépêche et son directeur sont « parmi les principaux artisans de la capitulation de la gauche devant les intérêts économiques et financiers », entraînant les députés radicaux du Midi « à faire le sacrifice de leurs convictions ». Rien de tellement surprenant, puisque dans ces années 20, le journal représente une « bourgeoisie provinciale, qui se piquait de radicalisme et de nationalisme, hostile aux idéaux révolutionnaires ». Arthur Huc s’oppose ainsi régulièrement au marxisme et au « mythe » de la grève générale, pendant que Maurice Sarraut dénonce le communisme, « ce détestable idéal de conceptions fondées sur la barbarie et la tyrannie cynique »6.
Dans sa thèse, Henri Lerner démontre aussi qu’après la crise des changes de 1923, la réaction des radicaux du midi « s’apparentait à celle des hommes de droite, dont ils partageaient la xénophobie, en soulignant le rôle nocif joué par les étrangers, mais aussi la nostalgie de l’ordre moral ». Dans les années 30, cette évolution à droite se poursuit encore. « Maurice Sarraut avait ainsi cessé d’être un homme de gauche pour adhérer à un centrisme mou qui reste désormais le fond de sa pensée ». En 1934, c’est lui-même qui est aux manœuvres pour imposer le gouvernement droitier de Doumergue, avec son frère au ministère de l’intérieur et Pétain à celui de la guerre.
Quant au Front populaire, c’est une alliance que La Dépêche subit, à reculons. Les radicaux sont exaspérés devant les occupations d’usines, et ils déposeront même un projet de loi pour les assimiler à un délit de droit commun. Avec la guerre d’Espagne, c’est une vague d’anti-communisme qui envahit leurs rangs. Avec La Dépêche, ils refusent l’intervention militaire et laissent l’Espagne tomber entre les mains de Franco. Maurice Sarraut approuve ensuite l’écrasement de l’anarchisme en 1937 et, lors de l’exode des républicains, c’est Albert Sarraut qui organise la mise en place des camps pour les y enfermer.
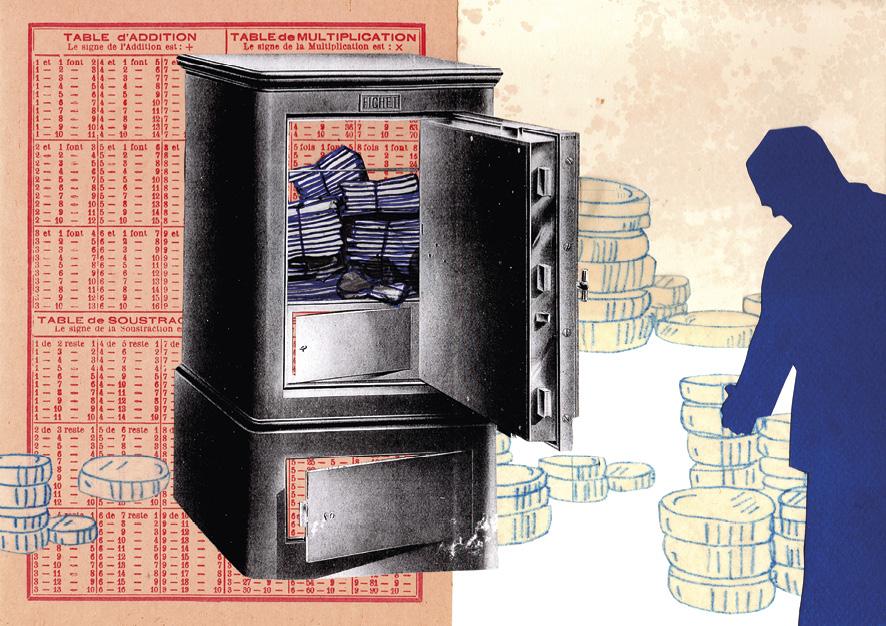
Dérive autoritaire
Passée la parenthèse du Front Populaire, la répression s’accentue sur les étrangers et les réfugiés politiques, de plus en plus considérés comme suspects par le pouvoir. Un cran est franchi par le gouvernement autoritaire de Daladier et son ministre de l’intérieur… Abert Sarraut. Ses décrets-lois de mai et novembre 1938 facilitent les expulsions et ouvrent des « camps de concentration » pour les « étrangers indésirables » qu’on ne peut pas renvoyer au pays. Son décret du 18 novembre 1939 permet d’enfermer dans des camps d’internement et sans jugement les « individus dangereux pour la défense nationale et la sécurité publique ». Il vise les communistes, les réfugiés juifs des pays contrôlés par les nazis, ou les repris de justice. Le 14 juin 1940, ce sont ainsi 2000 personnes qui sont raflées à Toulouse, alors que Sarraut est toujours en poste, puis envoyées par centaines dans les camps d’Agde, de Gurs, du Vernet ou de Rivesaltes. Elles y retrouvent des milliers de réfugié·es espagnol·es sous surveillance policière et entourés de barbelés, dans des conditions de vie déplorables. Ce décret de 1939 prévoyait une commission pour contrôler les arrestations à posteriori… Pétain n’aura plus qu’à reprendre cette législation en supprimant la dite commission.
On doit aussi à Albert Sarraut une bonne partie des mesures anti-communistes prises en 1939 (dissolution des organisations, sanction et révocation de fonctionnaires, etc.), que son frère Maurice approuve sans réserve dans ses colonnes.
La Dépêche a donc toujours soutenu la république. Oui, c’est un fait. Mais la république versaillaise, autoritaire, bourgeoise et colonialiste. En revanche, elle a peu goûté la république sociale, celles des communards et des grèves ouvrières.
Plus problématique encore est le penchant antisémite du journal lors de l’affaire Dreyfus, à la fin du 19ème siècle. Le rédacteur en chef Arthur Huc (qui restera à son poste jusqu’en 1932) n’hésite pas en 1898 à parler d’une « race inférieure perdue dans le culte du veau d’or »7. À l’époque, c’est le cas de tous les rédacteurs, selon Henri Lerner, dont « le parti pris frise l’antisémitisme de façon plus ou moins explicite ». C’est aussi le cas de l’ensemble des radicaux qui affichent les mêmes positions racistes, ou du futur directeur Maurice Sarraut, qui « n’était pas loin de partager le même état d’esprit »… avant d’opérer une tardive conversion au dreyfusisme.
Il ne s’agit pas ici d’affirmer que La Dépêche fut pétainiste avant l’heure. Mais en dépit de son opposition à la montée de l’hitlérisme dans les années 30, sa dérive droitière, tout au long de ce début de siècle, comme l’antisémitisme qu’elle exprima 40 ans plus tôt, peuvent expliquer son adhésion à la révolution nationale de Pétain ou son manque de réaction lors de la publication du statut des juifs.
Une affaire familiale
Avant guerre, le quotidien est un instrument de pouvoir politique et économique sans équivalent en province, et la direction de l’époque compte bien le conserver. La Dépêche est l’organe des radicaux du midi en même temps que leur direction, et opère « un véritable contrôle politique sur tout un groupe de départements »8, grâce à un réseau hiérarchisé de 2000 correspondants qui couvrent tout le territoire. Maurice Sarraut est non seulement à la manœuvre pour toute candidature dans le midi, mais il est aussi l’éminence grise de la 3ème République. Pour certains, il est même de facto le président de la République de cette période. Avec le parti radical, il joue un grand rôle dans la formation de nombreux gouvernements où des ministres « dépêchards » ont leur place, et notamment son frère Albert. Sarraut a en retour un droit de regard sur toutes les nominations de magistrats ou de fonctionnaires d’autorité du Sud-ouest. Ainsi, d’après Henri Lerner, grâce au quotidien les frères Sarraut édifient leur « fortune politique » avec « une sorte de féodalité de hauts barons qui régnaient dans le sud-ouest »,
À la veille de la seconde guerre, La Dépêche est une grosse entreprise commerciale très prospère, détenue par un clan familial. Après avoir pris le pouvoir en 1909 grâce au soutien du prince de Wagram, un noble marié à la baronne Bertha von Rothschild, Arthur Huc et Maurice Sarraut détiennent la majorité des actions. Ils se marient tous deux aux sœurs Anezin, une famille de riches commerçants marseillais. Quand Huc décède en 1932, Sarraut devient directeur, entouré de son fils Étienne, son neveu Paul Huc, son petit-fils Lucien Caujolle et Jean Baylet, apparenté à l’une de ses nièces. Ce dernier est l’héritier d’un riche homme d’affaires du BTP, Jean-Baptiste Chaumeil, et deviendra le bras droit de Sarraut après 1935.
Leur société assoit son emprise sur la presse régionale d’année en année, avec un réseau de distribution et un équipement technique semblable aux grands quotidiens parisiens. Avec une partie de la fortune de Chaumeil à disposition, le quotidien s’est modernisé à un rythme surprenant. Entre le journal et l’imprimerie, il emploie déjà plus de 700 salariés, il construit un hôtel, achète des immeubles et de nouvelles rotatives modernes. Le tirage explose jusqu’à 280 000 exemplaires en 1934 et les bénéfices ruissellent comme jamais, pour atteindre deux millions de francs en 1938.
La plupart du patronat a composé avec le régime de Vichy et l’occupant, à de rares exceptions près, dont les dirigeants de La Dépêche ne feront pas partie. Fuir c’est abandonner leur capital ; il n’en sera pas question.
1940 : le soutien à Vichy
Le dix juillet 1940, tous les radicaux votent les pleins pouvoirs à Pétain, Albert Sarraut y compris. La révolution nationale est bien accueillie par son frère Maurice. Selon l’historien Jean Estèbe, « Sarraut et son équipe, tout en conservant l’espoir d’une restauration de la démocratie, sont ralliés au gouvernement du Maréchal, jugée la seule solution réaliste »9. On supprime les institutions et la république, la droite extrême occupe les sommets de l’État, un régime autoritaire et policier se met en place et exclut les francs-maçons, juifs ou dissidents, Toulouse devient « la capitale française de l’internement et des camps »10. Mais les dirigeants de La Dépêche estiment que ce régime est un moindre mal. Selon Henri Lerner11, « le profond respect que Maurice portait au Maréchal fut certainement pour beaucoup dans le véritable naufrage moral qu’il connut alors ». Dans des courriers à ses journalistes Perdriat ou Martin du Gard, « il affirmait son attachement indéfectible à la personne du maréchal, en termes d’une chaleur même insolite ».
Maurice Sarraut ne semble pas prêt à abandonner son influence politique. « Il avait toujours trop vécu dans l’ombre du pouvoir pour accepter de s’en détacher », estime Henri Lerner, et il a réagit « en vieux routier radical avec un jeu à trois, dans le but de conserver une certaine influence à Vichy, en s’entendant avec Vichy contre l’occupant ». Il constate en outre que « le comportement de la Dépêche est assez largement représentatif de l’attitude adoptée par la majorité des radicaux qui, hormis quelques brillantes exceptions, sont restés à l’écart des courants de pensée et des organisations de la Résistance ». Si après quelque temps Maurice Sarraut semble prendre ses distances avec Vichy, l’historien souligne qu’il « s’est bien gardé d’exprimer ouvertement sa pensée dans ses écrits ou dans ses propos officiels, et il s’est désolidarisé du régime tout en continuant à insérer les papiers qu’on lui demandait ». Sarraut choisit la carte de l’attentisme, en espérant que la situation évolue. Mais en continuant à paraître, il porte « l’art du compromis à un niveau métaphysique », se soumettant « à des obligations qui lui ôtaient toute liberté réelle ». Dans le même temps, il ne s’empêche pas de célébrer la « charte du travail » de Vichy dans La Dépêche fin 1941, laquelle interdit grèves et syndicats, et dont Lerner affirme qu’elle a eu « l’adhésion sincère de Maurice Sarraut ».
Si le directeur fait un temps profil bas et se cantonne à la direction du journal, il garde une amitié personnelle avec des conseillers proches de Pétain, tels que Henry Moysset, Lucien Romier ou Gaston Doumergue. Lerner affirme qu’il s’entretient souvent avec Perdriat, son rédacteur en chef, favorable à l’entente franco-allemande : « Il a écouté attentivement jusqu’en juin 41 les avis de ce journaliste, très apprécié par Pierre Laval [vice-président jusque décembre 1940]». En réalité, il reste donc à proximité des cercles du pouvoir. Le 18 avril 1942, le voilà qui « accueille favorablement le retour de Pierre Laval aux affaires [en tant que chef du gouvernement]» selon l’historien Félix Torrès12. Il convainc même son ami René Bousquet d’accepter le poste de chef de la police de Vichy, lequel organisera les grandes rafles de juifs de l’été 1942 et la traque des résistant·es sur tout le territoire jusqu’en décembre 1943.
Réformer Vichy, un pari risqué
D’après la journaliste Pascale Froment13, La Dépêche « a beau se conformer aux règles de la censure et donner de réels gages de complaisance vis à vis du régime, elle n’en est pas moins considéré par les collabos comme un symbole de la « démocrassouillerie ». Jean Estèbe explique qu’aux yeux de la milice Maurice Sarraut est « une abominable crapule » quand dans le même temps« la Résistance haïssait le journal au service de Vichy et de la collaboration »14. Ni résistant ni collaborationniste (au sens de la frange extrémiste, antisémite et pro-allemande), à partir de 1942 Sarraut n’est plus totalement vichyste non plus… Dans cette période, son quotidien refuse d’imprimer certains appels de la Légion, du PPF, de la milice ou un texte anti-juif. La situation est de plus en plus tendue ; Sarraut est arrêté par la Gestapo toulousaine en janvier 43, puis libéré sur les ordres de René Bousquet.
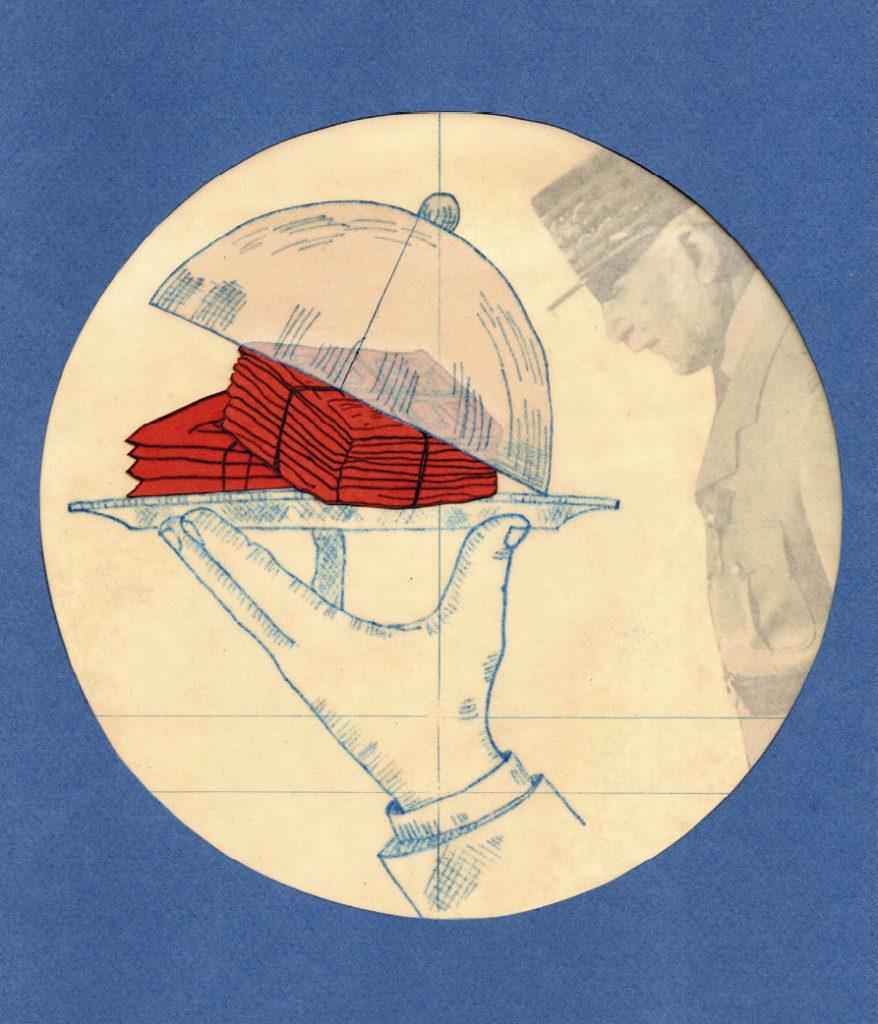
En 1943 et jusqu’à sa mort, il est à la manœuvre. De rendez-vous en conciliabules, il consulte ses proches ou d’ancien parlementaires, dont il devient le centre de ralliement. « Il ménageait toujours Pétain, qu’il jugeait encore apte à assurer la transition s’il se débarrassait de Laval pour s’entourer de gens sérieux comme Henri Moysset et Lucien Pomier, capables de faire l’intérim et de préparer les problèmes de l’après guerre », affirme Henri Lerner. Sarraut semble chercher à remettre Vichy sur le chemin de la république (sic), et reste en négociation avec Pétain, notamment via Roger Perdriat. Selon certains, pour « rénover » Vichy ; selon d’autres, pour préparer avec le maréchal un gouvernement provisoire qui écarterait De Gaulle après la victoire des alliés. Reste que Pétain envisage bien un Vichy plus « libéral » à l’automne 1943, et qu’il compte sur Sarraut pour jouer un rôle dans le nouveau gouvernement. Selon Jean Estèbe, il aurait accepté à condition qu’on rétablisse le parlement et la liberté de la presse. Au moment d’annoncer à la radio ses projets, le 13 novembre 1943, Pétain est interdit d’antenne par les Allemands qui imposeront ensuite une orientation fasciste et milicienne au régime de Vichy, avec l’entrée au gouvernement de Darnand, Henriot et Déat.
C’est donc au cœur de cette crise politique, quinze jours plus tard, que Sarraut est assassiné. On pense à un acte de la résistance, mais c’est la milice toulousaine qui tire les balles. Le plus probable est qu’elle entend mettre fin aux tractations de Sarraut avec Pétain, craignant la formation d’un « maréchalisme républicain ». Toujours est-il que Pétain déplore la mort de ce « grand français en réserve », Laval confie à Perdriat qu’il fera tout pour punir les assassins, René Bousquet assiste aux obsèques en tant que « grand ami du défunt » et parvient à arrêter les assassins quelques jours plus tard.
Dans un premier temps des tracts et des journaux résistants rendent hommage au patriotisme de Maurice Sarraut. Tout cela est confus, mais une chose est certaine, il n’a pas été exécuté pour avoir été résistant. En janvier 1944, les journaux de la Résistance livrent leur version. Libérer et fédérer condamne « un virtuose des combinaisons politiques (…) qui voulait sauver à la fois Vichy et les députés félons » ; Francs-tireurs affirme que « la Résistance n’avait rien à voir avec Maurice Sarraut, c’était pour nous (…) l’éminence grise d’un ancien régime pourri par toutes ces défaillances » ;Libération soutien que « Maurice Sarraut n’était pas de nos amis (…) Tombé sous les balles allemandes, il a racheté ainsi, involontairement, les erreurs de sa vie politique »15.
Une résistance individuelle
Pour alimenter la thèse d’une Dépêche résistante, la famille Baylet insiste aussi sur la déportation d’Albert Sarraut et de Jean Baylet, moins de trois mois avant la libération de Toulouse. Si Félix Torrès ou Henri Lerner estiment que celle de Baylet est, au moins en partie, due à son activité proche de la résistance, toutes les autres sources évoquent une déportation de notables dans laquelle ils sont embarqués. Quelques jours après le débarquement des alliés en Normandie, les allemands effectuent en effet une vague d’arrestations d’hommes de toutes tendances politiques, des hauts fonctionnaires de Vichy et des Ecclésiastiques qui pourraient prendre part à la nouvelle administration, afin de désorganiser le pays. Ils entreront dans la catégorie des « déportés d’honneur »16, ce qui, selon Pascale Froment, constitue la marque qu’ils n’ont pas été déportés en tant que résistants. Ils sont arrêtés en même temps que le maire Vichyste de Toulouse, le banquier Courtois de Viçose, des policiers ou militaires gradés, des magistrats, préfets, évêques, etc.
Aussi atroce soit le meurtre ou les déportations de ses dirigeants, cela n’enlève rien aux responsabilités de La Dépêche dans son choix de collaborer. Pascale Froment résume fort bien la situation : « À l’instar des radicaux qui se prévalurent évidemment davantage de leur martyrologie et des résistants qu’ils comptaient dans leurs rangs (mais dont la démarche, répétons-le, fut individuelle) que du silence de leur parti et de la masse des attentistes, La Dépêchebrandit l’assassinat de Maurice Sarraut, la déportation de son frère Albert, de Jean Baylet (…) ainsi que l’authentique combat de certains de ses rédacteurs »17.
À côté de certains journalistes clairement collabos comme Roger Perdriat, le quotidien comptait en effet quelques résistants parmi ses salarié·es : les journalistes François de Tessan et l’inspecteur Negrail, arrêtés en 1943 et déportés, morts à Buchenwald, Jacques Guillemin-Tayrare abattu dans les rues de Toulouse par la milice, le typographe Roger Derrac et l’ouvrier Aussaresses, respectivement déporté et disparu au maquis, ou encore Irénée Bonnafou qui participa à un réseau de renseignement à Montauban. L’ancien communiste Claude Llabres souligne que nombre de correspondants, rédacteurs ou ouvriers de l’imprimerie étaient contre le gouvernement et certains dans la résistance, car selon lui «la société La Dépêche et ses administrateurs seuls ont trahi »18.
Le doute subsiste pour Jean Baylet, dont des historiens évoquent l’activité dans le Tarn-et-Garonne dans une filière pour cacher des juifs, dans l’aide matérielle à certains résistants ou l’impression ponctuelle d’un journal clandestin. D’autres sources lui nient toute participation à une organisation. Ainsi l’ancien résistant toulousain Pierre Bertaux est catégorique : Albert Sarraut et Jean Baylet furent déportés « à titre de notables et non en tant que résistants, ce qu’ils n’étaient à aucun titre »19. Jean Estèbe estime quant à lui qu’ils sont tous deux sur cette liste car la Gestapo les avait dans son collimateur à cause de « l’influence politique occulte qu’elle leur attribuait », mais il n’évoque rien à propos d’une activité résistante.
D’une manière générale, La Dépêche pouvait servir de lieu de réunion dans certaines agences, ou apporter une aide ponctuelle en matière de faux papiers par exemple. Lucien Cajolle, membre du trio qui dirige le quotidien dans les derniers mois de 44, livrait sa version à la fin des années 90 : « Je n’ai jamais assisté à des actes concrets qui puissent faire penser que Jean Baylet était résistant. Notre Résistance, à La Dépêche, c’était de faire établir un faux certificat de Baptême à quelqu’un de proche, avec l’aide d’un commissaire de police. Nous n’avons pas fait sauter de train. Nous étions contre la milice et les salauds, c’est tout »20.
À la toute fin, en mai 1944, Jean Baylet prend contact avec la résistance. Le journal vient d’être suspendu provisoirement par la censure. Sentant le vent tourner, le dirigeant se tourne vers Jean Cassou, résistant et futur commissaire de la république à la Libération, et lui demande s’il est plus judicieux de refuser de reparaître et se faire confisquer l’outil de production, ou de poursuivre pour mettre le journal au service de la Résistance. Cassou lui donne l’ordre de reparaître, mais il précise que le problème de La Dépêche reste entier sur les années qui se sont écoulées, à propos de « l’attitude qu’elle a prise pendant une période de collaboration molle à quoi a succédé une période de collaboration dure »21. En réalité, Claude Llabres estime que le but de cette « ultime manœuvre » est clair : Jean Baylet craint une réquisition à la libération, ce qui est déjà prévu pour les titres qui ont continué à paraître après 1942.
Profits de guerre
Pour prouver que le journal avait « résisté de [son] mieux »22, le clan Baylet se retranche après guerre derrière l’action d’une censure impitoyable. Certes les historiens Lerner et Torrès listent des exemples d’articles tronqués, d’autres imposés, ou un subtil jeu autour de la mise en page, du choix des titres, des communiqués refusés, etc. Cependant, si La Dépêche a mené bataille contre les services de Vichy, une chose est sûre, c’est qu’elle l’a perdue dans les grandes largeurs. Et dans les comptes-rendus du conseil d’administration comme dans les échanges avec les censeurs ou le gouvernement, rien n’indique un défaut de loyauté envers Vichy, du début à la fin.
Ce qui est plus rarement mis en avant, c’est que pour un journal qui a ferraillé avec la censure et qui a pris ses distances avec Vichy, l’occupation fut une drôle de réussite économique. Le tirage pointe à 250 000 exemplaires en 1941, 310 000 en 1943. Le chiffre d’affaires explose, de 50 millions de francs en 1938 à 100 millions en 1943 ! Les bénéfices sont tout autant impressionnants : 25 millions en 1940, le double en 1941, 75 millions en 1942, 62 millions en 1943. En pleine guerre, la direction investit dans une rotative Marconi géante pour un coût de 20 millions, elle rénove toute son imprimerie et rachète la société méridionale d’impression, qui imprime le Midi socialiste. Alors que la population vit les restrictions, les rationnements et la pénurie de logements, les hommes de La Dépêche doublentleur salaires, passant en trois ans de 575 000 francs à plus d’un million pour Sarraut, et de 360 000 francs à plus de 600 000 pour Jean Baylet. Tous ces chiffres sont plutôt de nature à évoquer une entreprise qui collabore allégrement : c’est bien Vichy puis les allemands qui fournissent le papier pour imprimer le quotidien à des centaines de milliers d’exemplaires.
Certains vont jusqu’à dire que c’est cette dimension économique qui est le moteur principal de la collaboration. Certes, La Dépêche a alloué une partie des bénéfices (48 millions) aux œuvres sociales pour son personnel, et notamment pour aider les familles dont les hommes étaient requis au STO ou partis au maquis. C’est « le côté croix rouge » de Maurice Sarraut, évoqué par Henri Lerner : « Républicains, espagnols, israélites, francs-maçons, la liste des proscrits qui bénéficièrent de la protection de la Dépêche fut assez impressionnante ». Mais ce qui peut racheter une conscience ne peut effacer le rôle politique qui a été le leur.
Même Félix Torrès, l’historien le plus en faveur de La Dépêche, reconnaît qu’elle « oscillait entre collaboration et résistance », avant de reprocher qu’elle soit « devenue toute entière vichyste »23 aux yeux de certains. Mais le problème aujourd’hui, n’est-il pas qu’elle soit devenue toute entière résistante aux dires de la famille Baylet ? Ne faut-il pas faire confiance aux organisations de la résistance qui publient un an après la libération un réquisitoire24 qui évoque « la trahison constante et organisée » des dirigeants du journal et « cet enfer de boue où s’abîma un journal en qui des républicains avaient foi » ? Ou à Pierre Bertaux, ancien résistant et commissaire de la région à la Libération : « Non que les administrateurs de ce journal eussent été des collabos convaincus, pas plus d’ailleurs que la majorité des rédacteurs. Mais force est de constater que, depuis l’armistice de 1940, le journal s’était mis sans réserve au service de la politique poursuivie à Vichy par Pétain et Laval ».
Car au milieu des rafles et des persécutions, les dirigeants de La Dépêche ont choisi de continuer à paraître et d’être le passe-plat de la propagande vichyste. Le meurtre du directeur et la déportation à la fin de la guerre de Baylet et Sarraut ne viennent en aucun cas effacer cette attitude collaboratrice. Ceux et celles qui ont subi le martyr étaient dans les journaux clandestins, où plus de 400 sont morts pour avoir écrit, imprimé et distribué les idées de la Résistance. Ils et elles furent traqués par la police de René Bousquet, qui bénéficia d’un acquittement à la Libération et qui reprit du service à la fin des années 50… à La Dépêche.
Texte : Émile Progeault / illustrations : Le Chat bleu
Lire aussi
L’épisode précédent (1/3) : 1940-1944. Le journal de la démocratie se vend à Vichy
L’épisode suivant (3/3) : Bousquet, un criminel de guerre chez les Baylet
- La Dépêche, 26/06/1997.
- « 1940-1944 : Le journal de la démocratie se vend à Vichy », L’Empaillé n°5, été 2022.
- Cité dans La Dépêche, journal de la démocratie, Henri Lerner, thèse publiée aux Publications de l’université du Mirail, 1978.
- Ibid. Les citations suivantes d’Henri Lerner sont tirées du même livre.
- Ibid.
- Ibid.
- Article du 9/11/1894. Il récidive un mois après le « J’accuse » de Zola, le 19/02/1898 : « Il existe des races médiocres et qui (…) excitent l’antipathie et récoltent de la défiance ».
- Ibid note 3.
- Toulouse 1940-1944, Jean Estèbe (professeur d’histoire à l’université du Mirail), Ed. Perrin, 1996.
- Ibid
- À partir de là, les citations d’Henri Lerner proviennent de la version originale de sa thèse soutenue en 1975. Elle comporte notamment le chapitre XXV, « Au temps de Vichy et de l’occupation », qui ne figure pas dans l’édition de 1978 et pour lequel il a eu accès aux archives privées de La Dépêche.
- La Dépêche du midi, histoire d’un journal en république, Félix Torrès, Hachette, 2002.
- René Bousquet, Pascale Froment, Ed. Stocks, 1994.
- Ibid note 9.
- Ibid note 12.
- Ces personnalités déportées comme otages seront notamment dispensées de travail. Pierre Bertaux parle d’une « déportation bourgeoise qui n’avait rien de commun avec celle de nos camarades envoyés à Mathausen, à Revensbruck ou Dora » (cf note 19), même si une partie ne reviendra pas du camp de Neuengamme où ils seront envoyés.
- Ibid note 13.
- La Dépêche du midi et René Bousquet, un demi-siècle de silences, Ed. Fayard, 2001.
- Libération de Toulouse et de sa région, Ed. Hachette, 1973. Pierre Bertaux fut résistant et nommé commissaire de la République à la Libération de Toulouse.
- Ibid note 13.
- Ibid note 19.
- Argumentaire de Jean Baylet dans le cadre de l’inculpation du 11/09/1945 contre Albert Sarraut, cité par Felix Torrès (cf. note 12).
- Ibid note 12.
- La résistance présente La Dépêche, brochure cosignée par plusieurs organisations, mouvements et partis de la Résistance. En ligne ici.
