Kokopelli démasqué
Nous n’irons plus pointer chez Gaïa, paru aux Éditions du Bout de la Ville, est incisif, cru et intelligent. Issu de la rencontre entre jardinières ariégeoises et ancien.nes salarié.es de l’association Kokopelli, ce livre témoigne de ce que le milieu associatif bio fait de pire : se parer d’un masque vert pour mieux cacher ce laid visage du plus classique des profiteurs capitalistes.
Pour en savoir plus sur l’état de l’univers semencier et du marché bio, on s’est entretenu avec deux de ces jardinières et un membre de la maison d’édition. La critique est cinglante…
7 Juin 1997. En Ariège, trois cent militant.es pénètrent dans un champ de colza transgénique et arrachent pas moins de deux mille mètres carrés estampillés Monsanto. C’est le premier coup d’une longue série porté à la recherche agro-industrielle. Jusqu’à l’arrêté de juillet 2004 interdisant la mise sur le marché de colza OGM, les actions sont nombreuses et l’essentiel des essais de culture OGM en plein champ est détruit par des activistes.
Parallèlement à ces actions de sabotage, une vive agitation anime des collectifs qui commencent à se poser la question de la contre-attaque, jusque dans nos propres potagers. Pendant que Monsanto met au point le Terminator, sa dernière ignominie pour rendre un plant OGM complètement stérile; d’autres commencent à à s’organiser et à se fédérer en vue de la réappropriation des semences par ceux qui les cultivent. À cette époque, Kokopelli participe de cette constellation d’associations et d’organisations comme le Réseau semences paysannes ou Passe-graines qui luttent contre l’agro-business et l’État.
Business semencier
Les jardinières nous mettent en garde : on ne peut évoquer Kokopelli sans mettre un pied dans l’univers compliqué de la semence, et donc de son histoire.
Aujourd’hui, le marché de la semence est divisé en deux catégories : agriculture industrielle d’un côté, jardinage et maraîchage artisanal de l’autre. Depuis le début du 20ème siècle, on sélectionne et on modifie les semences pour les adapter à la mécanisation et aux produits phyto-sanitaires. Par exemple, le blé se fauchait facilement à la faux. Avec l’arrivée de la moissonneuse-batteuse et des engrais chimiques, les variétés traditionnelles à longues tiges ne sont plus cultivées : il faut désormais un brin dur et court adapté aux machines. À l’INRA (1), on crée de nouvelles variétés adaptées aux nouvelles conditions de cultures. On instaure un Catalogue Officiel des variétés homologuées pour forcer le marché agricole à prendre le tournant productiviste, déclarant au passage illégale la vente de semences absentes du catalogue ! Ce mouvement continue aujourd’hui, avec la fabrication constante en laboratoire de nouvelles variétés résistantes à tel pesticide ou à tel engrais. C’est un appauvrissement programmé dont les conséquences sont assumées sans états d’âme. La France, du fait de la précoce et intense implication de l’État, a été « pionnière » dans ce phénomène aujourd’hui planétaire.
Côté jardinage, c’est un énorme marché, épousant parfaitement le phénomène de périurbanisation (soit le retour des citadins vers les campagnes, les périphéries ) : pas moins de douze millions de personnes achètent des graines tous les ans. Et au sein de cette manne, un marché de niche, la semence bio. L’essentiel de la clientèle de Kokopelli est constitué de ces petits jardiniers. « L’association » se trouve pile dans ce créneau qui a le vent en poupe, là où il devient in d’avoir trois poules et quatre tomates anciennes au fond de son jardin. Les catalogues de tous les grainetiers ont aujourd’hui, chose incontournable, leur panel de graines bio et anciennes. Bien sûr, il y a un intérêt à sauvegarder certaines variétés anciennes ou rares. Seulement, cette problématique ne peut pas être détachée d’autres questionnements autrement plus concrets : qu’est ce qui pousse localement ? Quelles cultures sont cohérentes par rapport au terroir ? Qu’est ce qu’induisent la conservation ou la création de graines en terme de réappropriation du circuit de la semence ? Quoi qu’il en soit, il nous paraît bien plus utile et intéressant de défendre un jardinage vivrier plutôt qu’un appétit de collectionneur.
Les paysans ont perdu leurs semences anciennes. La plupart d’entre elles, en tout cas. Cette réalité est beaucoup plus dure à accepter que les catalogues ripolinés pour jardin bio-bio, images d’Épinal. On entend parler de temps en temps d’une variété conservée, mais ce phénomène concerne des cultures d’agriculteurs qui résistent, les musées… ou les banques privées et publiques de semences.
Ces semences traditionnelles, les laboratoires de recherche les gardent précieusement dans leurs coffres-forts réfrigérés. Ils y sont effectivement contraints pour pouvoir bidouiller, créer des hybrides ou des OGM, avec les caractéristiques qu’ils cherchent à obtenir. Pour bien comprendre : l’appauvrissement précédemment évoqué – et provoqué – pose forcément des problèmes, par exemple lorsque les chercheurs se rendent compte que telle variété de colza se trouve massivement attaquée par des insectes devenus résistants à tous les pesticides. Il faut alors trafiquer de nouveau, en laboratoire, une nouvelle espèce de colza. C’est là qu’interviennent les semences anciennes, indispensables à cette étape de recherche et de recoupement des variétés.
C’est ce qui explique que les banques de semences d’État ont fait appel aux petits jardiniers pour mettre en culture certaines semences. Si celles-ci se conservent parfaitement bien , dans des frigos géants, elles ne se multiplient pas. Elles ont besoin de vivre ; sous-entendu : d’être plantées, cultivées, pour être mises ensuite à la disposition des labos… L’État va donc relâcher peu à peu sa législation pour les jardiniers et leur dédier un catalogue spécial. Et des associations ou des syndicats produiront légalement ces graines spéciales. Et les commercialiseront, par la même occasion, puisque un marché s’est constitué dans la foulée des luttes écologistes.
Comble de l’ironie, ce sont les ennuis judiciaires de Kokopelli provoqués par sa transgression des lois du secteur semencier qui ont boosté ses ventes en le faisant connaître au delà des cercles militants. Profitant d’une image de victime de la répression mais surtout de David éco-responsable se battant contre les Goliath de l’industrie de la semence. Désormais, Kokopelli fait du business librement, sans complexe sur le terrain du Capital, vert et bio.
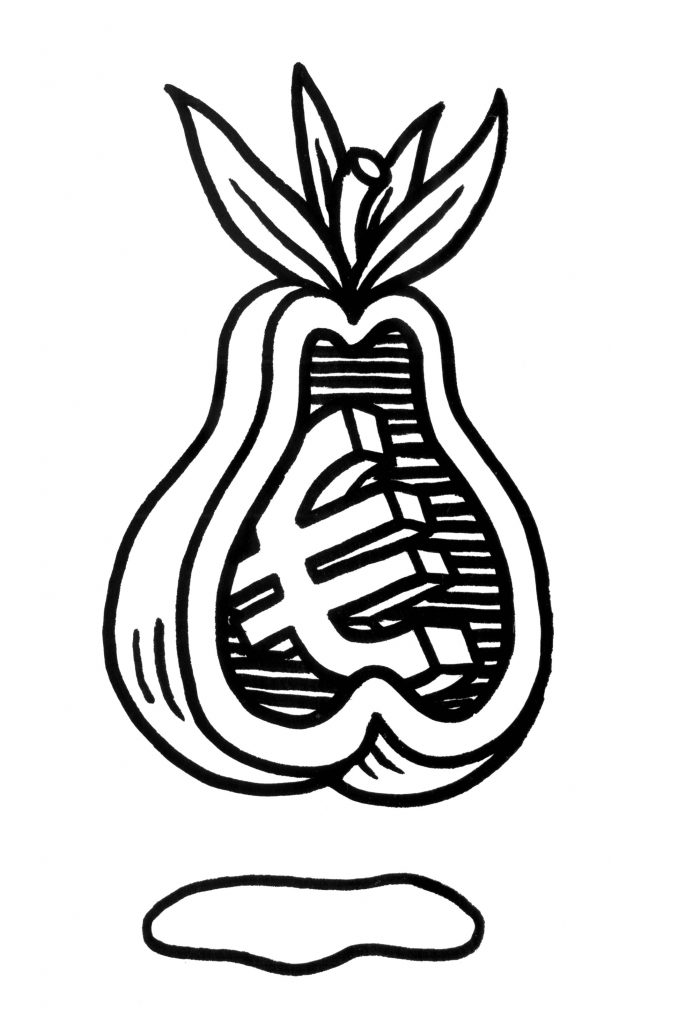
L’Amazon de la semence bio
Kokopelli œuvre en « rassemblant tous ceux et toutes celles qui souhaitent préserver le droit de semer librement ». Précisons la méthode : une plate-forme de vente en ligne. Un commerce d’import-export, avec tout le dispositif induit en terme de gestion managériale : flashage des produits, discussion avec le client inexistante, pause au rabais, quantification du travail des employés pour les mettre en concurrence, avertissements punitifs, absence de mutuelle, développement des contrats précaires… L’objectif : la productivité encore et toujours. Une organisation basée sur les techniques de grands groupes qu’ils dénoncent.
Le management Kokopelli est directement importé des États-Unis où la famille Guillet, patronne de l’empire, a séjourné. Depuis que les nouvelles formes de gestion du personnel venues tout droit de la Silicon Valley envahissent l’univers des start-up, les patrons repensent totalement leur rapport au personnel. Pas qu’ils se soient soudainement pris d’humanisme vis-à-vis de leurs salariés, non, simplement la productivité augmente à mesure que les équipes sont soudées et les salariés « heureux ». Ainsi naissent de curieux métiers : « team-builder », comprenez : « fabricant d’équipes », on vous organisera des sorties avec vos collègues dans un Laser-Quest pendant vos heures creuses ; ou encore, Chief Happiness Officer, chef du bonheur – une gentille personne qui te souhaitera ton anniversaire le jour idoine, ou t’installera dans la pièce de méditation entre midi et deux. Cet environnement doucement totalitaire, Guillet s’en est inspiré bien avant tout le monde. Bien sûr, il reste une pointeuse, comme témoin d’un autre temps où le fordisme des grandes usines accouchait bien malgré lui d’une conscience de classe, forte et ancrée. Il reste aussi les cadences, « infernales, impossibles à suivre », selon une ancienne salariée. Mais cette boîte-là, c’était aussi la famille. Alors on se retrouvait en fin de journée pour chanter ensemble, avec le patron comme chef de chœur. Et chose incroyable, ça marchait : une fois l’équipe soudée à bloc, les salarié.es sont à l’heure, se fliquent les un.es les autres et intériorisent les normes fixées par la hiérarchie. Parce que chez Kokopelli, sa vie que l’on donne pour l’entreprise, ça n’est rien d’autre que de l’épanouissement personnel.
Là encore, tour de passe-passe perfide, en avançant la nécessité de défendre la cause. Les salarié.es qui osent dénoncer leurs conditions de travail deviennent les bourreaux, tandis que le pauvre patron critiqué incarne leur victime. Pourtant ce personnel a toutes les bonnes raisons de se révolter. Dans une ambiance soupçonneuse, les temps de pause sont écourtés et le personnel épié, il est interdit de parler aux collègues pendant les heures de travail.
La crainte de finir aux Assedics puis aux minimas sociaux finissent de souder les salariés à ce boulot de merde. En effet, l’Ariège est le dixième département en France métropolitaine ayant le plus haut taux de RSA, le taux de chômage est de 14,8 % contre 10,8 % au niveau national.
Alors que dehors le mouvement contre la loi travail fait des étincelles, des salariés décident de rompre le silence. Les premiers témoignages contre le système Kokopelli se libèrent peu à peu. Les quelques employées dénonçant ces méthodes se trouvent isolées face au reste de l’équipe qui reste coûte que coûte soudée au patron.
« Nous n’irons plus pointer chez Gaia », à travers ses témoignages, apporte un regard de l’intérieur et a permis de redonner la parole aux humiliés. Dans ces lignes, ce sont les exploités eux-mêmes qui analysent, sous leurs multiples aspects, dans la finesse, les abus qu’ils ont subis. Ce travail intellectuel met en exergue un cas d’espèce qui révèle ce qu’est le monde aujourd’hui.
Le coup fatal
Kokopelli a été créée sous une forme associative en 1999. Une jolie facette qui induirait des rapports humains construits sur l’échange et la transmission. Et bien non. Le masque tombe. La façade alternative se brise pour laisser voir le pire. En effet, point d’organisation horizontale. Le président, ou devrait-on dire le patron M. Guillet, gère ses employés et dirige ses affaires tel un commandant. Les adhérents n’ont pas de prise sur les directions que choisit l’association et n’ont pas d’espace où prendre la parole lors des simulacres d’assemblée générale.

Même l’enrobage autour des « petits producteurs locaux » n’est qu’un argument marketing. Le rapport avec les petits semenciers est catastrophique. Ces derniers, à l’époque des faits révélés dans le livre, n’avaient aucun contrat et se voyaient imposer les tarifs, bas évidemment. Le statut précaire par excellence. Au-delà de ce rapport dominant et étouffant, les producteurs n’avaient pas de suivi ou d’échanges autres que commerciaux. La gestion des semenciers locaux devient par conséquent très compliquée. Résultat des courses : pour la majeure partie de ses graines, la boîte s’est tournée vers les géants bio aux États-Unis (High Mowing ou Organic Seed) ou dans l’Union Européenne (Suba Seed, Essem’bio, Sativa). Ces mêmes géants sur lesquels la famille Guillet crache pour dorer son image. Un grand écart de première classe.
Sous cette belle robe bio-alterno et militante, on s’attendrait à des semences de qualité. Le masque sombre au fond du précipice : semences merdiques. Les graines n’ayant pas été testées, souvent mal conservées. Les acheteurs pardonnent : même si leurs légumes ne poussent pas, ils auront nourri la « cause » pour un monde meilleur.
Puis, le masque disparaît, il se disloque dans les entrailles d’une faille sismique. Lorsque Kokopelli trouve une solution pour rentabiliser les semences périmées : « Semences sans Frontière » s’occupe de tout. L’association se charge d’envoyer – via cette campagne – des graines dans « les pays les plus pauvres (2 .) » pour soutenir « les paysans du monde ». Un bon moyen d’écouler les surcharges de stocks, sans trop de tracas puisque l’association ne se préoccupe ni du devenir ni de la réussite de cette démarche, mais se contente de joindre une fiche technique. Emballer c’est poster, les voilà solidaires des besogneux, le label tiers-mondiste en poche. Joli exemple de condescendance intéressée de l’occidental à la rescousse des pays qu’il a colonisés. De quoi appâter dons et mécénats vers Kokopelli…
On remerciera Kokopelli de nous faciliter la vie. J’achète donc je milite. C’est le concept du consom’acteur, ou comment rester dans son canapé en préservant la planète. Peut-être l’intention première de cette démarche était bonne, aujourd’hui, elle est définitivement récupérée. De la même façon, on peut être nommé chevalier de l’écologie en donnant cinq euros par mois à Greenpeace ou acheter les produits emblématiques de Biocoop pour cumuler les points sur sa carte « consom’acteur Biocoop Biosphère ». 250 points donnent une remise de cinq euros, nous voilà économes, écolos, bons en affaire, sauveurs du monde et la conscience tranquille. C’est ainsi que sur le thé de la boîte « Jardin de Gaia », il est écrit en gros, en travers du paquet « Thé militant kokopelli ». Amen
La question politique du bio est posée. Le marché est en pleine expansion ces dernières années et les supermarchés spécialisés fleurissent par centaines dans les zones commerciales. Si le bio offre des produits avec moins de pesticides, il n’est pour autant ni une démarche révolutionnaire ni une solution pour la planète. Il peut aussi être un marché capitaliste avec toutes les injustices et les perfidies qu’il comprend.
Bien que les différentes enseignes se parent de « prix justes », les pauvres n’ont pas accès à ces produits. Et nous ne pensons pas « réduire notre empreinte écologique » en se délectant de purée de noix de cajou importées du Brésil, achetée entre 12 et 15 euros le pot. « Consommer mieux » pardi ! Le bio est avant tout un nouveau marché envahi par les capitalistes : les géants s’en emparent, dévorent en goinfres ce concept et ainsi surgissent Carrefour Bio, Cœur de Nature chez Auchan, Naturalia (groupe Casino), etc. Dans ce grand cirque, il n’est pas surprenant de voir se multiplier les polémiques autour de l’estampillage bio (3).
Voilà donc le triste tour de passe-passe que le XXIe siècle a produit. Le militantisme devient un argument marketing et le livre cible un exemple frappant. L’achat d’un sachet de thé ou de graines commandés sur Internet peut-il remplacer une philosophie, un mode de vie, des valeurs, un engagement politique ? Le capitalisme nous fait croire, comme à son habitude, qu’acheter nous dispense de réfléchir aux fondements de notre organisation et de notre système. Nous laisserons-nous berner ?
Nous entendons déjà les commentaires « Mais ils ne sont jamais contents ceux-là », ou « ils ont la critique facile, c’est de la caricature ». Rassurez-vous, il ne s’agit pas de cracher dans toutes les soupes, mais de rester vigilant au coup de filet, celui qui récupère les bonnes actions pour les transformer en business. N’est-ce pas Kokopelli ?

1.Institut National de Recherche Agronomique.
2.Voir directement sur le site de Kokopelli, la page Semences Sans Frontière.
3.Suite à la publication de la norme ISO 16128, des produits cosmétiques contenant des ingrédients chimiques et polluants pourront légalement se revendiquer bio. Sur les OGM, les réglementations diffèrent, et c’est donc la conformité aux exigences réglementaires locales qui s’applique. Comprendre : si le pays autorise, la norme autorise.
Le procès
Suite à la sortie du livre, la presse rédige sur le sujet : Le Monde, Le Canard enchaîné, nos amis du Chien rouge (CQFD). Un petit jardinier, faisant de la formation en permaculture dans le Tarn, écrit à son tour sur son blog un article « Pourquoi nous n’achèterons plus nos graines chez Kokopelli ». Cet article est relayé par les réseaux sociaux. Il y raconte sa malheureuse expérience avec les graines du groupe. Kokopelli choisira ce paysan pour attaquer en diffamation. On peut déceler un moyen facile de faire pression sur les sympathisants du bio, le milieu des jardiniers, afin d’éviter de nouveaux » sursauts » critiques. La plainte a été jugée non recevable par le tribunal.
Le bout de la ville
Les Éditions du Bout de la Ville sont nées en 2012 au Mas d’Azil en Ariège. À partir de témoignages ancrés, leurs livres étudient et critiquent notre société afin de faire surgir avec force les points de vue des opprimés, des délaissés, de celles et ceux qui tiennent tête à un système dont on ne comprend plus les assises. Ils mettent ainsi en exergue, différentes luttes : la paysannerie, la prison, le nucléaire, la gentrification. Les Éditions soutiennent aussi des films, toujours dans la même veine. Nous leur souhaitons longue vie.
Texte : L + J / Dessins : Léo
