« Nous avons fait un joli brouillon »
« Nous vous encourageons à porter avec nous cet élan pour agir sur deux tableaux, le mieux vivre ensemble à Vaour et la transformation sociétale de notre pays ! Vive l’amour ! Vive Vaour ! La mairie est à vous ! » Pour ceux et celles qui vivent sous le joug municipal de petits despotes, le discours du maire de ce petit village tarnais peut exercer un certain attrait. Mais parfois la réalité s’est montrée féroce avec cette expérience originale de démocratie locale…
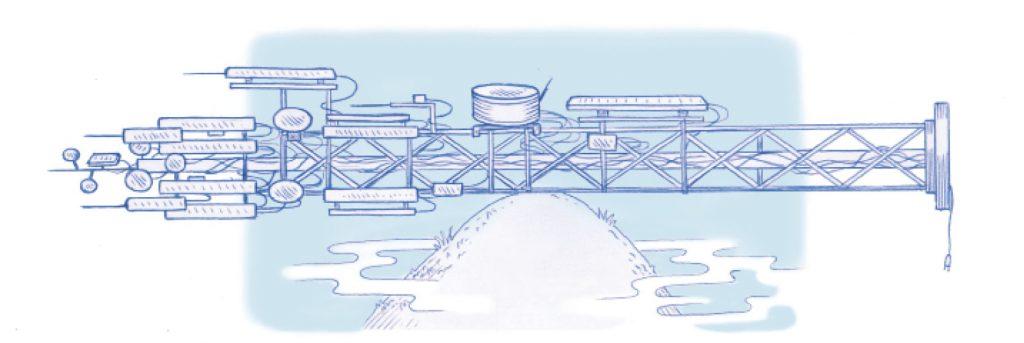
En cinq ans, ce village de 400 habitant·es situé au nord de Gaillac est devenu l’une des références pour les listes « participatives » les plus déterminées. En 2020, après plusieurs assemblées d’habitant·es de Vaour inspirées de l’expérience municipale de Saillans1, un modèle de fonctionnement va naître en allant plus loin dans la démocratie directe que les tentatives réalisées ici et là. Selon Julie Rigou, membre non élue du groupe de coordination municipale, « six mois avant, au moment de créer la liste, personne ne voulait y aller. Certains voulaient bien mettre leur nom mais avaient peu de temps, d’autres voulaient bien s’investir, mais sans mettre leur nom. Alors j’ai lancé comme ça : on a qu’à y aller tous ensemble ! On a qu’à dire qu’on met 11 noms mais en fait on est 20 ou 30 ! » Résultat : un « groupe de coordination municipale » qui regroupe onze élu·es et dix référent·es désignés dans les neuf commissions : social, culture, transition écologique, aménagement, communication, finances, eau, ressources humaines. Elles sont ouvertes à tous les habitant·es2. S’y ajoutent des sous-commissions, des groupes projets, des animateurices et secrétaires, des assemblées thématiques sous forme de « café citoyen », etc. Au total, une cinquantaine d’habitant·es se sont investis à différents niveaux, et chaque rôle est assuré en binôme. Le conseil municipal a bien une existence officielle, mais il est uniquement chargé d’enregistrer des décisions déjà prises dans les commissions et le groupe de coordination. Une forme d’horizontalité a donc réussi à se frayer un chemin pour travestir l’organisation municipale classique, verticale et souvent autoritaire.
Le bilan du mandat présente des dépenses « classiques », comme le remplacement d’une chaudière, la rénovation de la salle de musique, la rénovation de logements sociaux communaux, et des projets plus emblématiques comme le soutien à un atelier de transformation alimentaire paysan (la Sica), la mise aux normes d’une salle voûtée sous le théâtre, l’accueil d’une famille en difficulté originaire du Bangladesh dans un logement de la mairie, la création d’un observatoire de la biodiversité, ou le déménagement de la « maison des causses » dans de nouveaux locaux pour accueillir l’agence postale, Familles rurales, l’ADMR et France services depuis peu. Sans oublier le projet d’une maison d’assistantes maternelles ou la réflexion sur une cantine alimentée par des paysan·nes locaux et bio. Bien sûr il faut ajouter, en plus d’une charge quotidienne, des réformes ou des procédures imposées par l’État (PLUI, adressage, fibre, etc).
La défaite de la 4G
L’un des points noirs du mandat, c’est la validation de l’implantation d’une antenne relais sur la commune. Dans un premier temps, l’équipe municipale a refusé ce projet d’infrastructure sur le village, sans en référer à la population… avant de faire volte-face suite aux critiques que cela a suscité. Julie Rigou explique : « On a fait une sorte de mea culpa : on leur a expliqué qu’on ne les avait pas consultés sur ce sujet car on a des valeurs, et on a donné nos raisons. Et alors là, on s’est fait démonter, on a fait des réunions et des réunions, ça a été violent. Des pleurs, des cris, c’était très dur, et on a dû changer d’avis car sinon c’était le drame dans le village. » Un groupe de retraités aisés en faveur de l’antenne s’est mobilisé lors de ces assemblées : « Je pensais que le sujet de l’antenne allait faire bouger la partie des habitant·es de Vaour qui était susceptible de s’y opposer, explique l’adjointe Nathalie Mulet. Je ne décolère pas… C’est essentiellement les pro antennes qui étaient présents aux réunions publiques, à exprimer leur désarroi de ne pas avoir de réseau, à relater qu’untel a failli perdre sa femme parce qu’il n’arrivait pas à joindre les pompiers, ou que la mamie d’une autre ne pouvait pas téléphoner dans son jardin. J’espérais un réel temps d’échange dans le village. Mais ce temps nous ne l’avons pas pris ». Si une grande partie du village est solidaire de l’équipe municipale, Nathalie regrette que celle-ci ne soit pas vraiment soutenue : « Au début ils étaient là, c’était allez-y, allez-y ! Alors on y est allé parce que la dynamique était magnifique et ils ont disparu. C’est ce qu’il se passe dans toutes les mairies participatives : une fois que les habitant·es sont assurés que la gouvernance se fait correctement et qu’ils sont protégés, ils s’en vont. »
Mairie participative cherche équipe remplaçante
Au bout de cinq ans et demi, l’usure et la fatigue sont très présentes dans l’équipe qui s’est investie, notamment pour le maire et les deux adjointes, chargés des affaires courantes via le « groupe opérationnel ». Nathalie souligne que « c’est une charge de travail et une responsabilité énorme. On est vingt, avec neuf élu·es. Heureusement qu’il y a des non élu·es pour participer mais ce n’est pas assez, il faudrait qu’il y ait des trinômes sur les dossiers pour permettre aux personnes de s’impliquer à leur mesure. » Elle estime que l’équipe a mal estimé le boulot qui les attendait : « On était des bleus au début. Nous avons voulu trop faire, mettre trop de choses en place. Moi j’ai pris la commission aménagement qui est très lourde avec notamment le travail de mise en place du PLUI, et en même temps je suis adjointe et conseillère communautaire, référente enfance et jeunesse au niveau de la com com ». Résultat, Nathalie ne remet pas le couvert : « Je ne repars pas car je suis épuisée, et surtout parce que ce n’est pas l’objectif du participatif, ce serait prendre du pouvoir. Place à d’autres. »
Si elle accuse le coup dans cette fin de mandat, elle reste positive sur cette expérience : « Nous avons fait un joli brouillon au niveau de notre mairie participative, notre fonctionnement est réellement impeccable, de même que tout le travail de transmission d’informations dans le village, de communication que ce soit par l’affichage, la Vaourette [lettre d’info par internet], les boîtes aux lettres, et même au début par le crieur public sur le marché. On a essayé d’être au maximum à l’écoute de chacun et chacune, de prendre en compte leur réalité qui pouvait parfois ne pas être la nôtre. C’était et c’est encore très riche. Mais on n’a pas réussi à réellement impliquer les habitant·es, parce que nous sortons de décennies de maltraitance démocratique, et aussi du fait que les gens ont peu de temps à consacrer à cela. »
Julie va dans le même sens : « Tout le monde adore ce qu’on fait, mais les gens sont déjà investis sur mille trucs associatifs, politiques, militants. Tout est associatif chez nous : le bar est associatif, la médiathèque est associative… Alors on a tous cumulé plusieurs rôles : moi j’étais à la commission gouvernance, à la commission culture, j’étais animatrice et secrétaire. On a fait un énorme boulot de mise au point de ce schéma de gouvernance, et les suivants vont sûrement se le réapproprier, recréer un nouveau cadre. Mais on l’a quand même bien dégrossi. »
Face aux institutions
Certains habitant·es du village et des alentours sont plus critiques sur cette mairie participative. Ainsi l’un d’eux explique : « Ok, il y a une recherche de fonctionner de manière horizontale, c’est la forme : mais qu’est-ce qu’on veut sur le fond ? Et dans un conseil municipal, l’essentiel de l’ordre du jour est décidé par la préfecture, comme les réformes de l’adressage, le PLUI, etc. Il faut appliquer les réformes, et trouver des marges là-dedans. Appliquer ce qui vient d’en haut avec une énergie participative… La préfecture leur impose un calendrier, ça prend beaucoup d’énergie. Alors qu’est-ce qui reste d’alternatif à la fin, qu’est-ce qui change la vie ? »
Un autre souligne ainsi qu’un changement doit passer par le niveau de l’intercommunalité : « Aujourd’hui elle est le garant que l’État n’ait pas d’obstacle, les directives arrivent d’en haut, des préfectures, des ministères voire de l’Europe, et sont à peu près validées ». Il concède néanmoins que les élu·es de Vaour et de trois villages autour ont réussi à porter des positions dissonantes à cet échelon. Il pointe aussi la nécessité que l’implication dans des mairies soit articulée à un mouvement qui s’assume comme contestataire de la société, une dynamique que l’équipe de Vaour a porté, mais peut-être insuffisamment : « Tu es pris dans une gestion, dans plein d’impératifs, tu essaies de rendre service aux gens dans le cadre tel qu’il est, et si tu n’as pas d’autres moments dans un autre cadre qui te rappelle que le cadre institutionnel ne va pas, qu’il y a un problème dans l’organisation même de ces institutions, dans leur structure, leur verticalité… » Il ajoute : « En général, la plupart des élu·es municipaux se comportent comme des courroies de transmission de l’État vers les citoyens, alors que l’idée ce serait de faire l’inverse, en portant une parole de contestation vis à vis de l’État. Bien entendu, c’est pas simple : faire aujourd’hui des réunions publiques pour les prochaines municipales où tu dis ça clairement, tu risques d’agréger un peu moins de gens… »
De son côté, Julie défend cette expérience : « Ce que je retiens ? On est partis de rien, avec trois anciens élu·es, et que des novices. Avant je ne m’intéressais pas à la politique, et n’avais pas vraiment de conscience citoyenne, et là on se retrouve à gérer une municipalité, avec des budgets importants, avec la com com, etc. On peut être hyper fiers de nous d’avoir réussi à maintenir ce bateau, même s’il y a eu des blessés sur la route, franchement, on a réussi à gérer notre village, de la manière la plus participative ». Alors ce premier mandat était-il une sorte de crash test à partir duquel la prochaine équipe pourrait accoler une base politique plus forte et un élargissement des énergies pour ne pas finir sur les genoux en fin de mandat ? On leur souhaite bon courage !
Texte : Émile Progeault / Illustration : Triton
