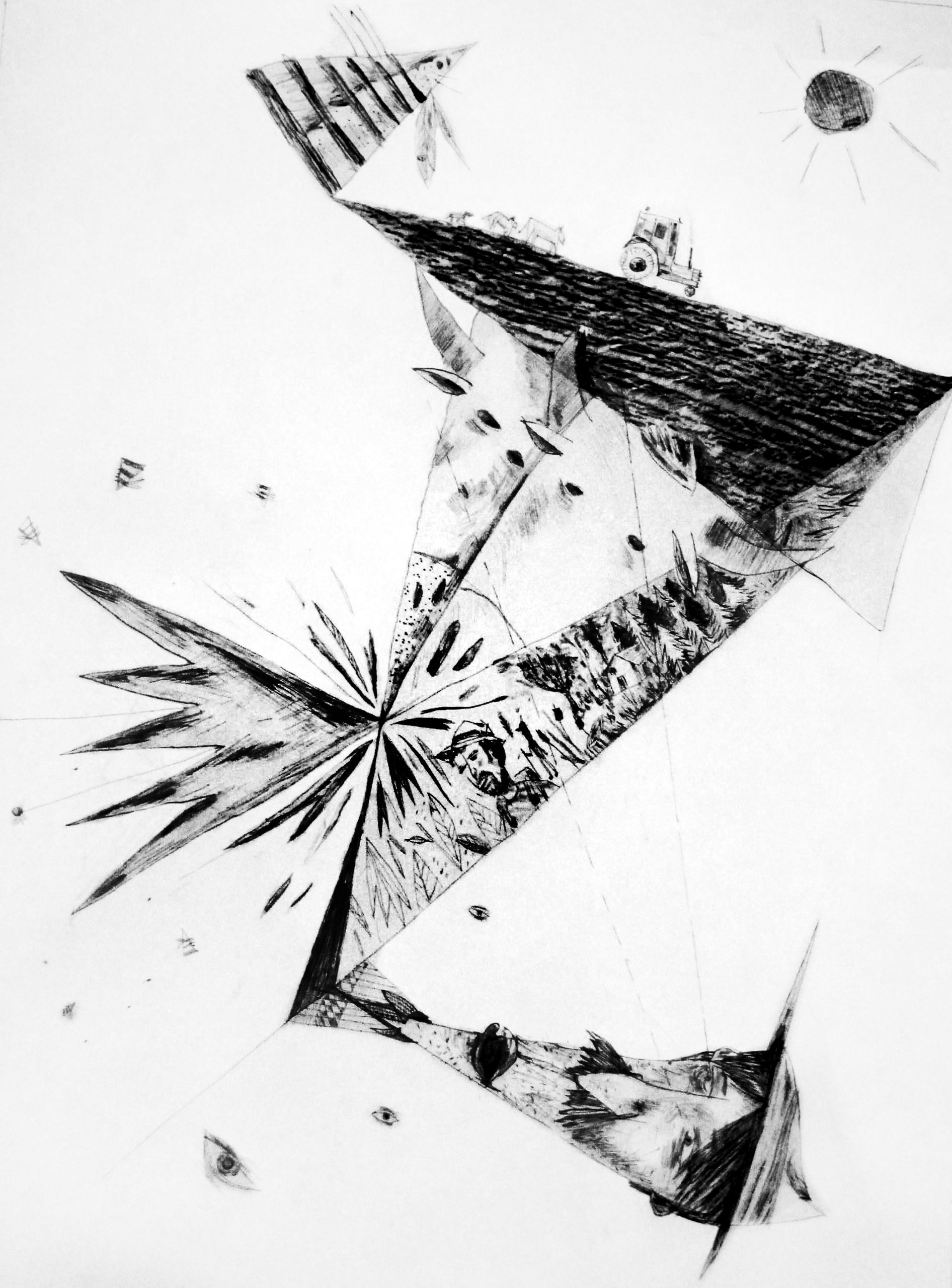Les « parisiennes su vallon »
Qu’est-ce qui pousse de jeunes urbain-es à quitter l’agitation de la vie citadine pour atterrir au milieu du middle-west aveyronnais ? Moult installations dans le vallon de Marcillac témoignent de l’actualité de la question. Ces nouveaux arrivant-es du XXIe siècle ne font qu’emprunter une route prise par une autre génération, celle de 68. Rencontre avec Gilou et Hélène, qui ont quitté le confort et le bouillonnement politique de Paris pour sortir des sentiers battus.

Elles ont la vingtaine dans les années 70. Une autre époque : celle du Général et de Pompidou, celle de la foi aveugle dans le progrès technique, celle des valeurs bourgeoises d’accumulation, de consommation. Des millions d’adhérent-es pointent au PCF et à la CGT. L’avortement est interdit. Les maos, les trotskistes, les anars sont en effervescence à gauche. Le Grand Soir, c’est pour demain.
Trajectoires
Gilou est alors prof à Paris. Quand elle se souvient de cette période, ses yeux pétillent : « C’était fou ! Il y avait beaucoup de gens qui partageaient un refus de la société bourgeoise. C’était le milieu MLF ou gauchiste. Un réseau très dense. Incroyable, incroyable ! C’était extrêmement intense et je crois très sincère. »
À cette époque, elle fait du théâtre avec ses potes profs et rencontre des maos et trotskistes qui habitent à l’équipe, un squat de Paris. Elle abandonne son poste à l’Éducation Nationale pour monter une école parentale (où les parents gèrent l’éducation de leurs marmots), la barque, hébergée dans un squat du 13e, au doux nom de l’immortelle éphémère. Elle s’engage ensuite au Mouvement de Libération des Femmes (MLF). « J‘y suis rentrée avec des copines médecins qui pratiquaient l’avortement illégalement. Moi, j’étais mère de famille. On allait dans les banlieues parler avec les femmes de la contraception, de la pilule, d’éducation sexuelle, sur le fait d’avoir des enfants quand t’en as envie. C’était des choses qu’il fallait gagner ; la pilule par exemple, ça débutait. Il fallait concrétiser ça avec des actes. Ça nous semblait mille fois plus important que les discours. »
Hélène vient d’une famille bourgeoise et catho. Elle est en fac de médecine dans le chaudron militant de ces années-là. Elle participe un peu aux AG de 68. « On a réussi à bloquer le pays, c’était super. Ça m’a ouvert les yeux. » Pour elle qui a fait l’école des bonnes sœurs, la révolution s’est faite dans l’abandon de ces valeurs. « À part pour le Larzac (1), on ne faisait pas de manifs. Quitter son boulot, une vie facile, ça choquait tout le monde. Les parents se demandaient comment on allait y arriver. » On l’oublie aujourd’hui, mais à l’époque, l’Église, c’était du lourd. Les ratichons et leurs patrons avaient un poids idéologique énorme. Avec son compagnon de l’époque, un peu bouddhiste, elle voulait « ne plus faire partie du système, abandonner le désir de consommation ».
Choisis ton camp, camarade !
Après la fin de mai 68, retour à l’ordre. Des élections législatives anticipées sont convoquées en juin 1968. Le Général triomphe avec 60 % des sièges. La France a eu peur des agitateurs ; le pouvoir siffle la fin de la récréation. On piétine la chienlit.
Parmi les tenants de l’idéologie, le PCF domine à gauche avec 21 % à la présidentielle de 1969. Ça bataille sévère chez les gauchistes, il y a les jeunes de Lutte Ouvrière, de la Ligue Communiste Révolutionnaire, entre autres. Entre toutes ces grosses machines, les collectifs plus petits se font une place. Gilou raconte : « Il nous arrivait de faire des actions avec LO, par exemple. On se rencontrait sur le terrain. Avec les cocos, les discussions étaient parfois assez violentes. Moi, ça me correspondait davantage d’être dans des petits groupes. Faire partie de groupes organisés, ça me semblait une norme, pas un choix. »
Pour elle, ça fonctionnait beaucoup entre femmes dans les squats. « C’était complètement égalitaire au niveau des rôles, c’était vraiment surprenant. Dans notre squat, en tous cas. On découvrait tout, l’égalité par exemple, on la revendiquait. On y prêtait une attention toute particulière. Je pense que ce n’était pas le cas dans tous les lieux. Aujourd’hui, dans le milieu libertaire, c’est considéré comme acquis alors que ça l’est pas du tout. » Camarades, c’est dit.
Quête de sens
Au milieu de ce bouillonnement urbain, comme beaucoup d’autres, Hélène et Gilou cherchent une autre voie. « Je voulais autre chose. Une vie plus vraie, à la campagne, loin des grands axes, des centres industriels », explique Hélène. C’est qu’à l’époque, les changements de routes étaient très faciles : « J’ai pas mal de copains qui ont arrêté tout ce qui était intellectuel et sont repartis vers quelque chose de manuel ou d’artistique. Rien ne semblait difficile. On était sûr de ne pas être tout seul sur la route. Aucun problème si t’étais en galère d’argent. On a crée une tontine (2) d’ailleurs [dans l’Aveyron] », raconte Gilou.
Sa première expérience loin de la ville se fait autour du théâtre dans un lieu collectif, le mas de France, dans le Tarn-et-Garonne. C’est joyeusement qu’elle arrive avec une vingtaine de ses potes, dont « beaucoup se sont mis en congé de l’Éducation Nationale – en congé psy [rires] ». Elle arrive finalement en Aveyron en 1975, à Conques, au hameau de La borie. Débute une autre vie en collectivité. « C’était extrêmement riche par rapport aux enfants. Toujours plein d’enfants. La mienne, par exemple, pouvait s’adresser à un adulte ou à un autre, pas spécifiquement au père ou à la mère. Je voulais leur montrer autre chose que le schéma traditionnel complètement sclérosant : papa, maman, on va pas dormir chez les copains, on part pas en vacances sans ses parents. »
Elles n’étaient pas les seules à rejoindre les vallons de l’Aveyron. Avec des réussites contrastées. « Plein de gens ont fait la même démarche que nous. Beaucoup ont abandonné. Trop dur. Pas d’eau, pas de téléphone ou faire trois kilomètres dans la neige pour travailler. C’est pas rien de passer du confort à rien du tout », raconte Hélène. Elles estiment que la moitié sont repartis en ville.
Soyez les bienvenus
Pour les gens du cru, ces nouveaux arrivants-es viennent de trop loin. « Beaucoup de gens d’ici nous considéraient comme des bons à rien, des fainéants, parce qu’on ne travaillait pas à plein temps ou alors pas du tout [comme salariés]. Ils ne pensaient pas que ça pouvait être possible) », se souvient Hélène.
Gilou abonde en ce sens : « Pour eux, on venait prendre la place de leurs enfants qui quittaient la terre. C’était le rejet. Quelques-uns nous appréciaient parce qu’on était très actifs. On faisait du jardinage, de l’élevage. Il y avait une reconnaissance par rapport à ça, ils nous aidaient, ils participaient à ce qu’on faisait. Mais très peu. Les corps étaient plus dénudés aussi ; ça choquait. Les gendarmes de Conques se planquaient dans les buissons pour venir mater les filles, quand on se baignait. ». La réalité, c’est parfois mieux qu’un film de De Funès.
« Pour eux, on était des filles faciles, ils tentaient leurs chances. On n’était pas fréquentables… À la cantine, les enfants étaient séparés (de ceux du cru). Les enfants de paysans n’avaient pas le droit de jouer avec les nôtres. « Jouez pas avec les enfants des hippies ! » On représentait un danger. Il y a eu un peu de considération quand ils ont vu que nos enfants étaient plus brillants que les autres », sourit Hélène.
Action rurale
Et l’action politique dans tout ça ? L’idée de Gilou était « d’approfondir le lien avec les gens par le théâtre. On faisait ce qu’on peut appeler du « théâtre engagé« . Pour créer du lien. Ça a très peu marché. Bien moins qu’à Paris. Les gens n’étaient pas prêts à recevoir ce qu’on voulait leur apporter. C’était trop loin d’eux et de leur vie paysanne. » Alors les modes d’actions changent. Notamment dans l’associatif. « On a monté l’Usine dans l’Aveyron. Une association multiculturelle, sur Marcillac, qui existe depuis vingt ans. On y fait de la danse, du théâtre, du cirque. »
N’était-ce pas décevant par rapport à la richesse de l’action parisienne ? « Bien sûr, il y a eu une forme de renoncement. Par rapport aux grandes idées, aux choix politiques. Mais notre réalité quotidienne recouvrait ces choix-là. Il y avait un réseau important dans le coin, on se rencontrait souvent lors des chantiers collectifs. On faisait par exemple de l’info par rapport à la pilule .»
« Sur le boulevard du temps qui passe » (3)
Elles sont restées dans le vallon, mais leurs enfants n’ont pas eu la même évolution face à cette vie. « Nos deux enfants n’ont pas du tout pris cette voie. Ils voyaient que les gamins des paysans avaient tout ce qu’il voulaient. Nous, on ne pouvait pas leur payer tout ça. Ma fille est juge à Lille, maintenant », explique Hélène.
La fille de Gilou est restée dans ce mode de vie. « Ce qu’on a fait, c’était pour nous et pour les générations futures. On pensait beaucoup à nos enfants. Ma fille m’en remercie tous les jours. Elle a suivi ma voie et s’est installée dans les Cévennes. »
De l’humilité d’une lutte (4)
Dans cette vague d’arrivée des années 70, il y a ceux qui sont restés et ceux qui sont repartis. Avec ces derniers, Gilou est sévère. « J’ai peu revu mes amis de Paris ou très peu. Plus envie, plus de raison. Ils ont fait des choix de vie très différents. Certains ont retourné leur veste. Ils sont retournés dans le système. D’autres sont repartis dans l’Éducation nationale, d’autres sont cadres dans des entreprises. Pas mal d’intellectuels. Ils ont repris un positionnement bourgeois. ». Trajectoire également prise par moult barons actuels du PS, comme Julien Dray, passé de la Ligue Communiste Révolutionnaire à l’amour des Rolex.
Hélène fait le même constat : « Certains ont complètement changé. Ils sont devenus PDG. D’autres ont fait l’expérience parce que c’était une mode. Sans forcément repartir ensuite dans une vie bourgeoise, mais juste à la ville.»
Finalement, ce sont d’autres qui ont pris leur place, explique Gilou : « D’autres gens sont arrivés ici. Le Guingois5, par exemple. On avait des choses à faire et à vivre avec eux. On a créé des liens. Des liens très forts. » Quarante ans plus tard, de jeunes citadin-es militants.es investissent à nouveau les campagnes. Des fermes collectives aux ZAD, du centre Bretagne aux Cévennes, de la Creuse à l’Ariège. Avec comme moteur, la conquête de temps pour vivre. Pour faire pousser ses légumes. Pour consommer local. Pour se dégager des contraintes du salariat et construire une autonomie matérielle et politique. Une lutte par l’exemple. À la recherche de cohérence dans l’absurdité de la machine capitaliste.
1. Lutte contre l’extension d’un camp militaire sur le causse du Larzac, de 71 à 81.
2. Caisse commune en cas de galère, sorte de mutuelle.
3. Excellent morceau de Georges Brassens sur la nécessaire modestie révolutionnaire.
4. À lire : Virginie Linhart, Le Jour où mon père s’est tu, Seuil, 2008, et Points, 2010.
- Lieu collectif autogéré de Marcillac-Vallon. Ouvert tous les dimanches midi !
Esteban et Amélie Macé